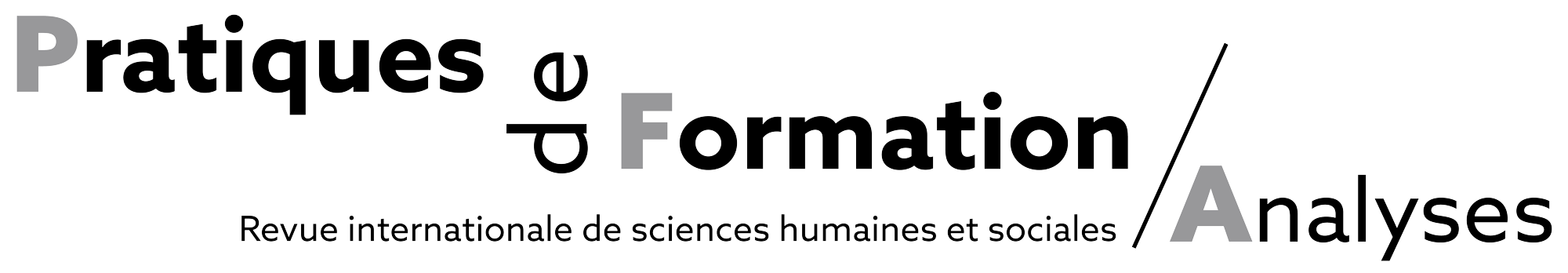Se déclarer « prof de pêche », au cours d’une conversation, engendre des réactions variées mais souvent des manifestations de surprise. Une fois écartée la confusion possible avec le ou la « guide de pêche », qui accompagne un pêcheur ou une pêcheuse de loisir sur une zone de pêche pour l’aider à sortir les plus beaux poissons-trophées, vient souvent la question : « Et tu leur apprends quoi, à tes élèves ? » Évidemment, lorsqu’on s’adresse à des professionnel·les de la pêche en France, il n’y a aucune surprise. Ils et elles ont tous connaissance des lycées professionnels maritimes (12 établis sur le littoral français), établissements publics qui dépendent du ministère chargé de la Mer. Le monde de la pêche professionnelle maritime est assez largement ignoré en France. L’enseignement dédié l’est encore plus. Pourtant, il existe depuis la fin du xixe siècle, sous des formes variées, et il est désormais impossible de devenir marin-pêcheur et pêcheuse sans passer par un centre de formation (en formation initiale ou en formation continue). Former des marins-pêcheurs et pêcheuses ne passe pas seulement par l’enseignement des techniques de pêche et du traitement des captures (qui sont l’apanage de l’enseignant·e de spécialité « pêches maritimes »)1 car les objectifs des écoles de pêche et autres écoles d’apprentissages maritimes sont multiples. À l’origine, la sécurité et la santé des marins sont une préoccupation majeure, notamment dans la perspective que les inscrits maritimes (il n’y avait alors que des hommes) sont appelés à servir dans la marine nationale en cas de conflit. La « moralisation » des populations maritimes est aussi un enjeu, autour de l’hygiène, de la lutte contre l’alcoolisme, etc.2. S’ajoute à ces objectifs, celui de l’amélioration de la performance de la flotte de pêche française, dans un contexte de développement industriel et de concurrence internationale. Les lycées professionnels maritimes (LPM) sont donc héritiers de cette histoire, tout en ayant vécu un rapprochement avec les autres systèmes de formation professionnelle par la voie scolaire que sont les lycées professionnels de l’Éducation nationale et de l’enseignement agricole. En ce qui concerne la formation initiale, ils dispensent aujourd’hui des CAP, des bac professionnels et des BTS, tous « maritimes », car sous la tutelle du ministère chargé de la Mer.
Ce cadre réglementaire passe par des référentiels de formation qui définissent les activités, les tâches, les compétences attendues. Ces référentiels doivent tenir compte du contenu des formations et des diplômes et brevets maritimes auxquels sont associées des prérogatives maritimes. Matelot pont, lieutenant de pêche, patron de pêche, capitaine de pêche, sont autant de brevets donnant droit à l’exercice de fonctions bien définies en fonction de la taille du navire ou de la zone de navigation… Mais du cadre réglementaire à la pratique, de la hiérarchie du bord à l’enseignement en classe ou en atelier, des bureaux à Nantes ou Paris jusque dans les LPM de Boulogne-sur-Mer, Paimpol, le Guilvinec, Ciboure, Bastia ou Sète, la réalité est complexe et fait apparaître des tensions très intéressantes à analyser. C’est donc à travers le cadre national de la formation que nous aborderons le sujet, en insistant sur l’intérêt d’une connaissance commune à cette échelle. Cependant nous verrons aussi à quel point l’ancrage à la fois dans un espace géographique et dans une pratique professionnelle concrète (les « métiers ») est indispensable, bien que complexe à traiter d’un point de vue de l’enseignement. Enfin, nous insisterons sur la perspective qui nous semble donner du sens à l’enseignement professionnel des techniques de pêche, à savoir la possibilité d’un dialogue entre acteurs et actrices, qui donne toute sa place aux marins-pêcheurs et pêcheuses eux-mêmes. En plus de quelques lectures, l’auteur s’appuie ici sur son expérience de 10 ans en tant qu’enseignant de « pêches maritimes » au LPM de Sète 10 ans, mais aussi sur son activité précédente de marin-pêcheur et de technicien halieutique.
Un cadre national intéressant et utile
La formation des marins-pêcheurs et pêcheuses n’échappe pas à l’organisation fortement centralisée de l’enseignement en France. Outre des aspects politiques et institutionnels, cette uniformité est aussi valorisée pour l’employabilité qu’elle permet aux jeunes marins. L’échelon national est ici vécu souvent davantage comme une ouverture mais peut être interrogé par des mobilités internationales.
Une « éducation nationale » maritime ?
C’est sous le régime de Vichy, en 19413, que les différentes écoles de pêche, sont rassemblées sous la tutelle de l’Association pour la gérance des écoles d’apprentissages maritimes (AGEAM), sous l’influence principale des Jeunesses chrétiennes maritimes. Et c’est au cours de la décennie 1980 que sont créés les CAP marin-pêcheur et que disparaît le certificat d’aptitude maritime, marquant ainsi le début d’un alignement sur les diplômes de l’Éducation nationale. De 19854 à 2001, les établissements sont gérés par l’Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole (AGEMA)5 avant d’être transférés au ministère chargé de la Mer et de devenir des lycées professionnels maritimes (LPM). Cette histoire d’un passage progressif vers le système public joue un rôle dans l’organisation de l’enseignement et dans la culture des LPM. Les relations complexes et ambiguës que les établissements entretiennent entre eux, avec leur tutelle ministérielle et le ministère chargé de l’éducation, seraient trop longues à étudier ici et nous éloigneraient du sujet. Cependant, il faut bien noter que les formations sont désormais construites sur le modèle de celles de l’Éducation nationale ou de l’enseignement agricole. Les arrêtés portant création des CAP, bac pros et BTS, même « maritimes » sont co-signés par ces ministères. Il s’agit bien de diplômes nationaux, dont les contenus, notamment en techniques de pêche sont décrits dans des documents officiels. On peut relever que la seule mention « les particularités locales seront prises en compte au niveau des travaux pratiques » dans le référentiel de formation du bac professionnel « conduite et gestion des entreprises maritimes option pêche » se rapporte aux notions d’océanographie « les océans et les mers ». L’océanographie fait partie de l’enseignement « conduite de la pêche », auquel on se référera souvent sous le nom trop restrictif mais plus usité de « techniques de pêche ».
Une employabilité basée sur des brevets maritimes
L’une des particularités des formations dispensées dans les LPM est qu’elles permettent la délivrance de « brevets maritimes » obligatoires pour exercer certaines fonctions à bord des navires, notamment de pêche. Ainsi, un brevet de « matelot de pont », « lieutenant de pêche », « patron de pêche » ou « capitaine de pêche » est indispensable pour travailler sur des navires de pêches. Cela engendre régulièrement des difficultés, en cas de pénurie de candidat·es « breveté·es », et constitue une véritable aubaine pour les jeunes qui obtiennent ces titres. Cette situation relativise les critiques que peuvent émettre les armateurs ou armatrices et les capitaines concernant le manque de savoir-faire des jeunes à la sortie de l’école. On assiste à un discours très prégnant sur les jeunes diplômé·es, qui ne maîtrisent pas l’ensemble des savoir-faire techniques : matelotage (les nœuds, les épissures) et ramendage (réparation des filets et engins de pêche), mais cela ne constitue pas toujours un frein à leur embauche, pour ces raisons de brevets obligatoires. L’enseignant·e de matière professionnelle se trouve de toute façon dans une certaine tension entre les attentes des entreprises, qui cherchent des personnes capables d’occuper un poste à bord et une multitude de facteurs qui s’y opposent.
Une ouverture vers l’autre plutôt qu’une fermeture ?
La situation des jeunes marins est parfois paradoxale : le métier leur permet une grande mobilité géographique, par la reconnaissance des brevets au niveau national et international (selon les normes STCW6), mais pour les pêcheurs et pêcheuses, l’ancrage local est souvent très important. L’exemple de la mise en œuvre des programmes Erasmus + est intéressant, avec des incitations fortes à la mobilité en Europe qui semblent souvent inadaptées pour des élèves qui n’envisagent déjà pas de se déplacer sur une autre façade maritime française. L’enseignement en techniques de pêche est un des facteurs d’ouverture vers d’autres possibles. En effet, l’enseignant·e est régulièrement confronté·e à des jeunes ayant déjà une expérience professionnelle réelle, que ce soit dans un cadre familial ou non. Ils connaissent alors le métier, ou plus précisément un métier, avec son vocabulaire, ses gestes, nous y reviendrons. Le rôle de l’école est alors de proposer d’autres regards, de faire découvrir comment font « les autres ». Vu depuis les bords de la Méditerranée, pour les élèves du lycée de la mer de Sète, ces « autres » se sont souvent des « Bretons », qu’ils soient de Normandie, du Boulonnais, de Vendée ou du Pays basque importe peu. Et il est vrai que le vocabulaire employé dans les référentiels de formation est plus proche de celui employé en Bretagne que de l’occitan. C’est alors que les parcours des enseignant·es en conduite de la pêche prennent toute leur importance. Selon leur origine géographique et leur expérience professionnelle antérieure, ils et elles auront plus ou moins assimilé les termes locaux et les termes « scientifiques » et seront plus ou moins prêt·es au dialogue et au jeu de la traduction. Restons un peu sur les mots : les échanges avec les fournisseurs de matériel ou la lecture d’un catalogue sont un bon motif pour ouvrir les élèves au vocabulaire « officiel ». Les jeunes qui se projettent en tant que patron·nes voient l’intérêt de recourir au vocabulaire normalisé. L’enseignant·e se garde alors de leur dire que les fournisseurs de matériel de pêche ont acquis depuis longtemps l’habitude de jongler entre les noms régionaux…
La simple description des façons de travailler des pêcheurs et pêcheuses d’un autre port engendre souvent des réactions de la part des élèves du type : « ils sont bizarres ». La bizarrerie est toujours chez les autres, et heureusement, au sein d’une même classe, ces procès en bizarrerie permettent de montrer qu’on est toujours le bizarre de quelqu’un.
Dans les métiers de la pêche, la standardisation des termes techniques ne passe pas toujours par l’anglais. Pour les espèces capturées, le pêcheur doit utiliser un code espèce pour ces déclarations de pêche en 3 lettres, souvent basé sur cette langue, mais sur l’étiquette de vente, le poisson doit être présenté avec son nom scientifique, en latin. Le jeu est vite lancé :
L’enseignant : « Est-ce que vous connaissez le chinchard ? » Certains élèves font la moue, d’autres rient un peu puis l’un s’exclame : « Mais bien sûr, c’est le saurel ! » D’autres se tournent vers lui : « Qu’est-ce que c’est ça ? » L’enseignant : « le gascon, aussi… » Une grande partie de la classe opine, et un Marseillais intervient : « Ah, oui… Mais nous, on l’appelle le sévereau ! ». L’enseignant : « Eh bien désormais, on l’appellera Tracchurus tracchurus ou bien Tracchurus mediterraneus, selon qu’il s’agit du chinchard commun ou bien du chinchard à queue jaune… »
On a donc recours en permanence à des changements d’échelle, pour donner du sens à un enseignement qui se doit d’être le même dans toute la France, alors que la réalité est d’une finesse rare.
L’ancrage dans la réalité des métiers
Au lycée professionnel maritime de Sète, en section pêche, on trouve des jeunes originaires de tout le littoral méditerranéen et parfois d’au-delà (côte atlantique, outre-mer, étranger, …). Il s’agit presque toujours de garçons. Leur proximité ou distance au monde de la pêche est variable. On peut être fils de pêcheur, ou bien neveu, petit-fils, mais aussi avoir des amis dans le monde de la pêche ou n’avoir pas vraiment de lien hérité avec cet univers. Par contre, soit avant, soit au cours de la formation, des relations fortes se nouent avec une certaine pêche. L’acculturation au milieu maritime se fait dans des conditions bien précises… et souvent déterminantes.
Ports, zones de pêche… un ancrage et des liens
Au-delà du vocabulaire, déjà rapidement évoqué plus haut, l’implantation géographique des élèves est essentielle car la pêche est un art très localisé. Peu importe l’origine (comme ce jeune Lyonnais qui avait intégré le port de pêche du Grau du Roi), c’est la zone de pêche et le port qui comptent. Le port est le lieu de la sociabilité, donc de certains apprentissages sur les autres bateaux, les autres types de pêche, les relations entre flottilles, les questions économiques… La zone de pêche peut aussi constituer une sociabilité (on y croise les bateaux d’autres ports, on communique par VHF), mais représente surtout un rapport au non-humain. Les jeunes pêcheurs et pêcheuses ne disposent pas encore de toutes les connaissances des ancien·nes, mais s’y confrontent progressivement à travers quelques toponymes, quelques aphorismes… c’est une transmission ancrée dans des lieux. La classe de pêche est donc une expérience multiculturelle. Les jeunes confrontent leurs pratiques, souvent en affirmant la supériorité de la seule qu’ils ont observée. L’enseignant·e navigue alors entre le commun et le divers, tente les comparaisons et l’utilisation de termes techniques comme langue véhiculaire pour une culture commune. Il se retrouve cependant très vite confronté à une pauvreté des termes techniques et des généralités scientifiques par rapport aux expériences des élèves. Si l’on admet facilement ne pas pouvoir maîtriser tous les toponymes de la côte française de Méditerranée continentale, il demeure intéressant de saisir des noms communs vernaculaires qui désignent des paysages sous-marins ou des écosystèmes, comme les brondes provençales ou les tocs du Languedoc. Toute la difficulté consiste encore et toujours à mettre en valeur la richesse de ces connaissances vernaculaires, tout en transmettant la capacité à généraliser et donc à communiquer avec l’extérieur. L’enseignant·e peut alors insister sur le fait qu’il n’utilise pas toujours lui-même ces termes, mais les a appris, au contact d’autres élèves ou de professionnels, et qu’il a fait l’effort de les retenir.
Vocations, projets professionnels, métiers, des identités bien marquées
Les ancrages, pour les élèves qui se destinent à la pêche, ne sont pas que géographiques. On entre aussi très rapidement dans un métier, défini souvent comme la combinaison d’un engin, d’une espèce ou un groupe d’espèces et d’une zone de pêche. Les pêcheurs et pêcheuses sont plus ou moins polyvalent·es : le chalut et la senne coulissante sont pratiqués par des navires exclusivement dédiés à ces techniques de pêche, tandis que la famille des « petits métiers » combine différentes techniques au cours de l’année (pièges, filets, hameçons, etc.). La notion de « métier » est souvent très précise, désignant par exemple, les filets trémails à sole du large. À chacun correspond un rythme de travail, des connaissances sur les fonds marins ou le comportement des espèces marines. La sociabilité des pêcheurs et pêcheuses est aussi fortement liée au métier.
Durant la scolarité des élèves au lycée de la mer, l’équipe pédagogique cherche à leur faire connaître les différents métiers. Cela passe par les cours de techniques de pêche mais aussi par les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) : les stages embarqués. On constate cependant que les choix des élèves sont très rapidement arrêtés. Ce peut être en raison d’une expérience, bonne ou mauvaise, ou bien de l’histoire familiale, ou d’opportunités professionnelles. Souvent, les élèves affirment alors une identité professionnelle très forte, qui se vérifiera la plupart du temps dans leur carrière. Ils deviennent, quand ils ne le sont pas déjà en commençant leur scolarité, des spécialistes.
L’enseignant·e ne peut pas être aussi spécialiste que chacun des élèves dans son domaine. Il a alors pour tâche de généraliser, en se positionnant souvent lui-même comme apprenant·e, pour faire se rencontrer théorie et pratique. Sa crédibilité est une ligne de crête sur laquelle il avance, entre assurance de son savoir et ouverture aux apports des élèves. Il faut alors transmettre en même temps que les notions techniques, des notions transversales comme l’approximation, la règle générale-qui-connaît-des-exceptions.
L’enseignant : « En général, on laisse les filets trémails à langouste environ 48h dans l’eau. »
L’élève : « Nous, on les laisse 3-4 jours, sinon ça pêche rien ! »
L’enseignant : « D’accord, c’est possible aussi de les laisser plus longtemps, tu augmentes juste le risque d’avoir des langoustes blessées et puis tu tues quelques poissons pour rien, parce qu’ils se font manger ou bien sont pourris quand tu relèves tes filets. »
Impossible ici, justement, de faire part de la diversité des expériences et des connaissances des élèves. La détermination des élèves à exercer un métier bien précis constitue en revanche une difficulté par rapport aux programmes nationaux. L’évaluation locale, en « contrôle en cours de formation », permet davantage de souplesse, et de ne pas insister sur des aspects du référentiel qui ne correspondent à aucun projet professionnel des élèves. Cependant, certaines obligations subsistent : 40 % des items du référentiel de formation en « conduite de la pêche » concerne les chaluts. Le décalage est croissant avec la réalité méditerranéenne, où les chalutiers représentent 4 % de la flottille et 9 % des emplois7. Dans la pratique de l’enseignement, l’enseignant·e se trouve toujours confronté·e à l’insatisfaction des élèves qui voudraient entendre parler de « leur » technique. Besoin de se rassurer ou bien envie d’approfondir avec des apprentissages utiles ? Toujours est-il que beaucoup d’élèves demandent à apprendre ce qu’ils savent déjà…
La place des « néo-pêcheurs »
Il ne faut néanmoins pas négliger une part souvent discrète des élèves : les véritables novices. À des degrés divers, certain·es élèves sont extérieur·es au monde de la pêche. Eux aussi vont devoir jongler entre les connaissances empiriques de leurs collègues et de leurs premiers embarquements d’une part, et les connaissances scientifiques du lycée professionnel maritime d’autre part. Ils découvrent les deux aspects en même temps. Leur ouverture aux notions générales des sciences halieutiques est donc plus facile, même si elles sont souvent, dans un premier temps, abstraites. Le rôle de l’école est peut-être plus central pour eux et elles. Ces élèves ne viennent pas seulement chercher un brevet maritime pour leur permettre d’exercer le métier qu’ils ou elles ont déjà choisi, mais apprendre un métier et d’abord découvrir son univers. Là encore, les généralités des techniques de pêche, telles qu’elles peuvent être présentées dans des ouvrages de technologie des pêches ne suffiront pas. Pour susciter l’intérêt, l’usage de l’anecdote et donc la mise en situation sont essentiels. Lors des travaux pratiques, ces jeunes sans expérience s’avèrent parfois bien plus efficaces que des fils de professionnel·les, trop sûrs de ce qu’ils maîtrisent déjà et ne voyant pas l’intérêt des gestes transmis par l’enseignant·e.
Le lycée de la mer et ses sections « pêche » rassemblent pour quelque temps des futur·es professionnel·les destiné·es à s’éloigner à nouveau, tant dans l’espace que dans leurs parcours professionnels. Ce temps de formation constitue l’un des rares moments d’unité de la profession dans sa diversité.
Le dialogue entre acteurs
Loin de fonctionner en vase clos, comme « un monde à part », la pêche professionnelle et l’enseignement maritime sont dans la société8. La richesse des échanges avec les scientifiques, les administrations, les politiques, l’ensemble des partenaires, dépend de la capacité au dialogue, qui peut être facilitée dès la formation initiale. Cette ouverture peut aussi prendre forme au sein même de la profession et permettre à celle-ci de mieux appréhender les bouleversements qu’elle traverse. Enfin, la situation de l’enseignant·e en techniques de pêche est en elle-même une croisée des chemins qui mérite d’être prise en compte dans cette analyse.
Gestionnaires, scientifiques, partenaires : des acteurs importants
Nous ne ferons pas ici l’analyse de la construction des référentiels de formation. Sans doute y a-t-il dans ceux-ci une réappropriation du métier par des gens qui ne sont pas pêcheurs ou pêcheuses. La formation est autre chose que le métier. C’est ce que défend nécessairement une institution qui n’aurait, sinon, plus de raison d’exister. L’approche des techniques de pêche par les scientifiques n’est pas celle des marins-pêcheurs et pêcheuses. L’approche scientifique n’est pas non plus univoque. La place dédiée aux engins ayant connu le plus de développement industriel en France (le chalut et la senne coulissante), dans les enseignements reflètent une vision liée à l’ingénierie et au travail des technologistes des pêches. Par ailleurs, le classement des techniques, dans les référentiels de formation, n’est pas conforme à la nomenclature de référence au niveau mondial9. Et elle ne correspond pas non plus aux métiers, tels qu’ils sont vécus dans leur diversité par les pêcheurs eux-mêmes. C’est alors le rôle des sciences humaines et sociales, et en particulier de l’anthropologie ou des ethnosciences, que de participer à faire correspondre ces différentes approches des techniques de pêche10.
La maîtrise des codes institutionnels peut être présentée aux futur·es pêcheurs et pêcheuses comme un outil de défense de la profession, dans un contexte où les pressions augmentent. La relation entre les professionnels de la pêche et les autres acteurs de la gestion halieutique est en effet au cœur de conflits importants. Savoir s’exprimer dans le langage des institutions peut donc constituer un atout. C’est aussi un prérequis fondamental pour comprendre les avis scientifiques ou les réglementations. L’évolution et la complexification du cadre de l’activité halieutique nécessitent en effet de former des jeunes pêcheurs et pêcheuses capables de s’insérer dans divers dispositifs. On pense aux différentes aides dont ils et elles pourraient bénéficier, aux enjeux de la planification spatiale dans un contexte de diversification des usages de la mer. Les marins-pêcheurs et pêcheuses qui savent valoriser leurs savoir-faire et leur connaissance du terrain peuvent ainsi diversifier leurs sources de revenus, en participant à des campagnes scientifiques ou à des travaux en mer.
Pêcheurs et pêcheuses du monde : des langages variés pour une passion commune
Il existe différents moyens d’accéder à la diversité des pêches mondiales. Les ouvrages scientifiques de technologie des pêches constituent une source très intéressante pour les enseignants. On y trouve des plans d’engins variés, que l’on peut comparer à ceux utilisés par les flottilles locales. Ce travail de relevé scientifique permet des réflexions sur l’adaptation au milieu, depuis le comportement des espèces cibles, jusqu’aux matériaux disponibles ou aux conditions océanographiques. Souvent avares en texte rédigé, ces ouvrages de technologies des pêches sont pourtant des trésors ethnologiques ou historiques11. Ils permettent notamment de relativiser l’idée de permanence, souvent présente chez les jeunes pêcheurs (« Je ferai comme mon père, qui faisait déjà comme mon grand-père »).
On associe désormais ces ouvrages scientifiques aux très nombreux documents vidéo disponibles sur Internet et les réseaux sociaux. Si elles sont en général plus difficiles à interpréter, parfois sans localisation, ni date précise, les vidéos constituent des illustrations marquantes de la diversité des pratiques. L’enseignant·e peut alors s’appuyer sur les découvertes des élèves eux-mêmes, en cherchant à s’extirper du spectaculaire de l’image pour chercher les indices, les éléments plus techniques.
Montrer la variété des techniques permet l’analyse comparative et la recherche de points communs. Les élèves y sont généralement sensibles, simplement par ce qui les unit à tous les pêcheurs et pêcheuses du monde : trouver les ruses et les outils pour capturer des organismes vivants aquatiques afin d’en tirer un revenu. C’est en effet une réalité que les pêcheurs et pêcheuses aiment, en voyage notamment, « traîner sur les quais » et sont toujours sensibles aux pratiques des autres.
Quelle culture professionnelle pour l’enseignant·e de technique de pêche ?
Justement, le ou la « prof de pêche » n’est plus marin-pêcheur ou pêcheuse. Il ou elle touche un salaire fixe et travaille à terre. Cette réalité l’éloigne de ses élèves, qui se projettent en tant que pêcheurs. On entend par exemple « un prof de pêche est un mauvais pêcheur, sinon, il aurait continué sa carrière en mer ». Les stratégies de rapprochement sont alors indispensables pour toucher les élèves12 et elles se basent sur l’expérience des enseignant·es de technique de pêche, mais aussi sur leur capacité à s’intéresser à celle des élèves. Les parcours des enseignant·es sont divers. Les principales raisons des reconversions de marins-pêcheurs vers l’enseignement sont médicales ou familiales. Mais les compétences demandées par le métier d’enseignant·e sont de plus en plus larges (prise en compte des besoins particuliers des élèves, saisies informatiques, montage de projet, recherche documentaire, corrections et élaborations de documents numériques, etc.) et ne sont pas courantes chez les marins-pêcheurs. Toujours est-il que le goût de la transmission est indispensable et que chacun va développer ses enseignements selon ses sensibilités : les fondamentaux des gestes professionnels (l’art de réparer un filet ou de faire des nœuds), la sécurité, la variété des techniques, les technologies nouvelles, la durabilité des pratiques de pêche, etc.
Au vu de la diversité des métiers de la pêche, l’expérience professionnelle de l’enseignant·e n’est jamais suffisante. Elle sert avant tout à légitimer sa position. Il a donc recours, comme les autres enseignant·es, à la recherche documentaire et à l’élaboration d’outils pédagogiques sur l’ensemble des sujets qu’il doit aborder. Ce travail est d’autant plus exigeant qu’il n’existe pas de manuel de « conduite de la pêche » pour les lycées professionnels maritimes.
L’un des enjeux est aussi de se maintenir à jour, face à l’évolution des techniques, des écosystèmes et de la réglementation. Ainsi, l’enseignant·e peine de plus en plus, au fil des ans, à s’appuyer sur ses expériences, qui, anciennes, risquent d’être dépassées. Le discours devient parfois nostalgique. La rapidité des mutations du secteur rend ce phénomène extrêmement important. Si le recours à l’analyse historique est extrêmement fécond, il est souvent difficile, pour l’acteur impliqué lui-même, d’effectuer des comparaisons entre son expérience passée et la pêche au présent.
La formation « sur le tas » des enseignant·es en techniques de pêche (concernant tout aussi bien les techniques de pêche que l’enseignement) peut aussi constituer une source de diversité des points de vue. Ils et elles ne sont pas passé·es par un seul et même cadre. Pour autant, l’absence de formation au métier d’enseignant·e est aussi un facteur de reproduction des méthodes traditionnelles. Une réflexion critique et scientifique sur l’art d’enseigner aboutirait probablement à des pratiques largement renouvelées. Ainsi, certaines pratiques courantes dans d’autres disciplines et contextes n’existent quasiment pas en enseignement des techniques de pêche, comme par exemple l’évaluation par compétences ou le fait de construire la trace écrite d’une séance avec les élèves.
En conclusion, la question de l’action uniformisante de l’enseignement se pose d’une façon assez singulière pour les techniques de pêche dans les lycées professionnels maritimes. La liberté pédagogique et le mode d’évaluation pour les examens (les contrôles en cours de formation) permettent à l’enseignant·e d’adapter sa pratique sans remettre en cause le cadre national posé par le référentiel de formation. Il ou elle peut ainsi tenir compte des parcours et des projets des élèves. Les principales limites que l’on rencontre dans la présentation de la diversité de la pêche se trouvent du côté du temps, de la complexité, du niveau de détail. L’accès à l’information précise n’est pas toujours évident et alourdit à la fois le travail de l’enseignant·e et celui des élèves. C’est pourquoi il est intéressant de mener une réflexion sur les pratiques de l’enseignement des techniques de pêche, pour viser des améliorations pédagogiques. Cela passe par une meilleure définition des objectifs de cet enseignement. Celui-ci est très largement tourné vers l’accumulation de connaissances. Vu ainsi, une tension apparaît entre deux tendances : comme l’élève ne peut pas « tout savoir », on peut chercher à spécialiser, à pousser dans le secteur que l’élève connaît et a choisi. On peut aussi, et c’est souvent plus ardu, chercher à l’ouvrir vers ce qu’il ou elle ne connaît pas, lui présenter d’autres univers. En fait, pour nous, il s’agit avant tout de construire l’autonomie de l’élève. Cela passe par un certain niveau de connaissance et de savoir-faire, certes, mais aussi par une capacité à dialoguer. Il s’agit de donner à l’élève les capacités d’échanger avec ses pairs et avec des acteurs les plus divers possibles. Les outils qu’il ou elle acquiert lors de sa formation doivent lui permettre de développer des échanges d’égal à égal et ainsi connaître la véritable autonomie, celle qui ne suppose pas de tout savoir et tout faire seul·e, mais qui repose sur des relations d’interdépendance choisie et maîtrisée.