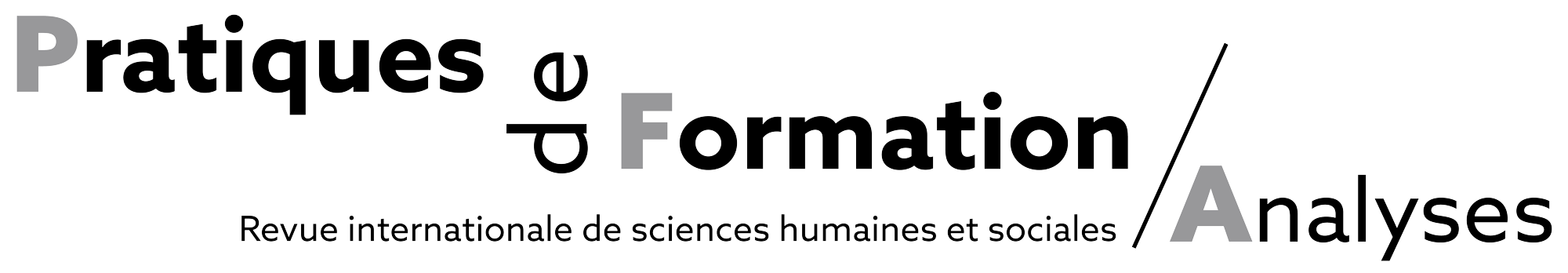Le partenariat, dans le champ de l’action sociale et médico-sociale
Corinne Merini, maîtresse de conférence en sciences de l’éducation proposait en 2001 la définition suivante lors de la journée nationale des OZP : « Le mot partenariat vient de l’anglais partner, il est défini comme une personne associée dans1. »
Plus récemment, en 2020, Régis Dumont y est allé également de sa proposition. Selon lui :
Pour faire face aux situations complexes, le travail social s’inscrit dans des logiques accrues de coopération, de collaboration, de mutualisation qui permettent de compléter, dans un contexte de rationalisation et de contrôle des coûts, une offre de service insuffisante pour répondre efficacement aux problématiques rencontrées et/ou aux nouvelles réalités2.
Durant mon cursus d’éducateur spécialisé et dans le cadre de l’élaboration de mon dossier de travail en partenariat et en réseau (DTPR), j’avais moi-même proposé la définition suivante : « L’action de joindre compétences et pratiques professionnelles dans un ou plusieurs buts communs. »
Mis à part quelques élaborations discrètes, et bien sûr les recherches de Fabrice Dhume3 consacrées entièrement à ce sujet, le partenariat dans le champ de l’accompagnement éducatif et social est encore très timide contrairement à d’autres thématiques comme la relation éducative4 ou encore la conception de « projets éducatifs spécialisés »5, qui semblent faire naître plus d’inspiration chez les auteurs les plus en vogue (incontournables diraient certains), du paysage médico-social français.
Cela peut s’expliquer par le fait que le partenariat est un concept relativement neuf : on retrouve la trace des premiers ouvrages francophones sur le sujet, au Canada (université de Laval), vers le milieu-fin des années 1980 (peu de temps après les États-Unis). Puis, des premières ébauches de partenariats dans les années 1985-1986, dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale, pour renforcer la collaboration avec la famille des patients, améliorer la communication et la coordination de parcours des soins de leurs proches et encourager la désinstitutionnalisation comme alternative à l’internement. Le Canada a ainsi suivi le chemin de l’Italie sur ce sujet, qui, avec la loi 180 (loi Basaglia) du 13 mai 19786 conduit à la fermeture des hôpitaux psychiatriques et les remplace par des structures de substitution plus axées sur les volets éducatifs, préventifs et communautaires. C’est probablement inspiré de ce modèle que la France expérimente par la suite la notion de partenariats de service public7.
Le 2 janvier 20028, les travailleurs sociaux sont invités par le législateur à renforcer leurs actions partenariales pour l’accompagnement du public. Un partenariat historique qu’il est possible d’observer cette année-là, est celui entre les instituts médico-éducatifs (IME) et l’Éducation nationale (EN), pour que les enfants en situation de handicap puissent bénéficier de cours « adaptés », délivrés par un(e) enseignant(e) spécialisé(e) détaché(e) de leur institution employeur. En résumé : l’Éducation nationale met à disposition d’une institution médico-sociale son personnel qualifié qui, en échange, a le devoir de délivrer le contenu de l’EN aux enfants handicapés, le tout dans un principe d’inclusion et d’égalités des chances. C’est d’ailleurs ce que l’on pourrait qualifier de partenariat de dispositif légal (de la même façon que dans le secteur de la prévention spécialisée, le partenariat fait partie des piliers de la profession d’éducateur de rue, au point qu’il est inscrit dans le cadre réglementaire de celle-ci.)
Le 20 juin 2007, les textes réglementaires du « nouveau » référentiel réformant le diplôme d’État d’éducateur spécialisé sont publiés officiellement : désormais, il est composé de quatre domaines de compétences pour valider le diplôme et celui du partenariat et du travail en réseau devient l’un d’entre eux, se classant aujourd’hui encore, en quatrième position dans l’architecture du diplôme9.
Ces deux notions sont donc très récentes : dix-sept ans de recherche et de travail sur ces thématiques. Soit quarante années de recherches et de reculs en moins que les autres domaines de compétences, sans compter celui sur la communication et le travail d’équipe qui lui, bénéficie d’élaborations scientifiques à ce sujet depuis au moins le siècle précédent10.
Peu à peu, nous passons d’une logique de coopération, à celle de travail ensemble, jusqu’à la construction du concept de partenariat. Et plus tard, de relation partenariale. Gaëtan Tremblay écrivait en 2003 :
Finalement, dans sa forme la plus accomplie et de façon générale, nous avançons que le partenariat résulte d’une entente entre des parties qui, de façon volontaire et égalitaire, partagent un objectif commun et le réalisent en utilisant de façon convergente leurs ressources respectives11.
C’est cette définition canadienne qui semble faire consensus aujourd’hui dans la profession. En résumé, il apparaît possible que par opposition à d’autres thématiques plus « anciennes » et faisant partie des racines de l’éducation spéciale, le partenariat cherche encore sa place : c’est aussi une thématique sur laquelle nous manquons encore de recul et réellement d’élaboration, voire de cadre juridique clair dans le champ de nos professions.
À cela, je pense en premier lieu à ces deux questionnements qui, pour l’instant, n’ont pas trouvé réponse définitive : la famille est-elle un partenaire ? L’ASE est-elle un partenaire ou un acteur interinstitutionnel ? Preuve que c’est encore un sujet parfois brûlant en « certification » ou en VAE, qui à la fois fait débat, et à la fois, ouvre des perspectives de recherches tout à fait intéressantes sur un sujet encore en pleine ébullition.
Mariage : origine, histoire et cas concret de « résistances partenariales »
Le mariage est encadré pour la première fois par la loi du 3 septembre 1791 (institution du mariage civil et laïc). Mais en réalité, cette tradition existe depuis l’Antiquité. À cette période de l’histoire, il s’agit d’une affaire privée, religieuse (peur du blasphème) et strictement ritualisée. Par ailleurs, les personnes célibataires étaient lourdement taxées. Les mariages étaient bien souvent arrangés pour des raisons économiques et sociales, les personnes se mariaient très jeunes (vers l’âge de douze ans). Avec le temps, non seulement les époux gagnent en droit et en réciprocité dans la relation, mais le mariage devient aussi plus officiel et encadré : par exemple, la publication de bans devient obligatoire, notamment pour lutter contre les mariages clandestins.
Le mariage connaît plusieurs évolutions au cours de l’histoire. En 1542, à l’occasion du concile de Trente, la loi précise que l’union des deux époux devra obligatoirement être célébrée par un curé et en présence de témoins. Durant l’Antiquité, il était possible de rompre cet engagement. Ce n’est désormais plus possible, car les époux s’engagent devant Dieu. Par ailleurs, ce sont les prêtres eux-mêmes qui tiennent et rédigent les registres d’état civil, pour s’assurer de cet engagement à vie.
Ce qui change avec la loi de la 1791 (en plus du fait que c’est désormais un officier municipal qui endosse la responsabilité de marier les deux personnes sur la base de l’état civil), c’est donc que le mariage est désormais plus encadré et surtout, qu’il est basé sur un consentement et un amour mutuels, dans un principe d’égalité homme-femme et, parce que ce n’est plus au père de choisir l’épouse de son fils. Il faudra d’ailleurs attendre l’année d’après, en 1792, pour instaurer également le droit de divorcer (qui sera abrogé en 1816 avant d’être de nouveau autorisé en 1975). Il faudra ensuite attendre 1985 pour que les époux obtiennent les mêmes droits (jusqu’ici, c’était au mari de décider si sa femme avait le droit de travailler).
L’échange d’alliances en est d’ailleurs un exemple concret : autrefois, la femme portait l’anneau pour signer son appartenance à l’homme. Nous passons d’un rapport patriarcal à celui du consentement mutuel, illustré maintenant par l’incontournable échange des deux anneaux12.
Le 17 mai 201313, la France devient le neuvième pays d’Europe (et le quatorzième pays du monde) à autoriser le mariage aux couples de personnes de même sexe.
Nous pouvons donc constater combien le mariage, ses principes et ses fondements ont évolué au fur et à mesure des siècles. Notamment sur le plan législatif. Un premier lien à faire avec le concept de partenariat évoqué quelques paragraphes au-dessus ? Oui, mais pas seulement… Un élément significatif dans l’histoire du public sourd, en s’y arrêtant, nous permet par exemple de nous questionner sur le poids de l’histoire et son influence, dans la démarche partenariale contemporaine.
En effet, j’avais personnellement observé lors de mon second stage d’éducateur spécialisé dans un établissement scolaire accueillant de jeunes élèves sourds, une résistance de la part de certains professionnels et de l’institution, au partenariat éducatif. Et plus précisément, à une ouverture vers l’extérieur. Alors même que c’est une des missions majeures de cet établissement (objectif d’inclusion dans la société). Cela pourrait paraître contradictoire et pourtant, j’ai constaté au fil des semaines que l’institution semble se suffire à elle-même et avoir de la difficulté à chercher des ressources à l’extérieur, puisqu’elle possède tout entre ses murs : un gymnase contenant son propre club d’escalade et qui accueille régulièrement des événements sportifs internationaux, un centre de recherche spécialisé, entre autres, dans le dépistage de la surdité, un service médical ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre et composé de professionnels : psychiatres, ORL, psychologues… L’institution accueille également en son sein des établissements scolaires et centres de formations professionnelles. Sans oublier un certain nombre de professeurs (de sports et de musique, par exemple), qui interviennent directement au sein de l’institution pour dispenser des cours particuliers. Tout est organisé pour que les jeunes puissent bénéficier d’un accompagnement global, le plus qualitatif possible sur le plan scolaire, éducatif, médical, loisir, sportif et culturel. L’institution fonctionne en vase clos (elle n’a pas de contact avec le monde extérieur) et elle semble être une structure bureaucratique (cloisonnement des fonctions, défense des intérêts de sa catégorie professionnelle, difficulté à aller vers14). Je me suis alors questionné longuement : le partenariat reste très timide pour une structure de cette envergure (la toute première créée dans le monde à destination des enfants sourds). Pourquoi les professionnels semblent-ils réticents à aller vers l’extérieur ? Après bon nombre de recherches, une hypothèse apparaît enfin : pendant longtemps, la langue des signes a été interdite car elle était considérée comme une entrave à la langue française (congrès de Milan, 1880).
L’institution dans laquelle j’ai vécu cette expérience est très fière de son histoire et véhicule des valeurs qui sont davantage tournées vers le travail en communauté que vers celui du partenariat. En résumé, mon hypothèse est que l’institution a appris à se suffire à elle-même et n’a pas pour coutume d’aller vers l’extérieur puisqu’elle fut longtemps exclue (l’institution par extension, mais surtout son public), par la loi et donc, par la société française. Et la question se pose légitimement : comment alors travailler l’inclusion dans une société excluante ? Du moins à l’époque (la LSF a commencé à se populariser avec « le réveil sourd » en 1976 puis de nouveau autorisé dans les écoles dans les années 1990, jusqu’à l’amendement de 1991 autorisant les parents à choisir une éducation orale ou bilingue pour leur enfant). Je n’utilise pas le terme « communauté » par hasard, puisqu’ils se définissent ainsi. Une véritable « communauté sourde » (qu’ils appellent également « culture sourde »), constituée après le congrès de Milan pour faire front contre cette décision légale d’interdire leur langue (c’est pourquoi le mot « langage des signes » est proscrit et discriminant auprès d’eux). Aussi, c’est à ce moment qu’ils se sont réunis en cachette pendant près d’un siècle, pour converser entre eux par langage codé et tisser des liens en cachette, entre opprimés de la société. Il y a aussi véritablement une consonance « identitaire » dans leur discours. Du fait de l’histoire de leur handicap, ils en ont fait une force et une identité propre. En effet, il faudra attendre la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées15, pour que la langue des signes française (LSF) devienne une langue officielle et que cela orchestre un changement de mentalité historique et conséquent. Désormais, ce sont nous entendants qui ne parlons pas leur langue (et quelque part, qui nous retrouvons handicapé), et non l’inverse. Une pensée d’ailleurs affirmée par Née dans un plaidoyer avant-gardiste lorsqu’il dénonce le fait que l’on a (aux personnes sourdes) « retiré la citoyenneté » ; que ses pairs sont exclus de la société (« leur dénierez-vous encore le sens du patriotisme ? »”, « leur dénierez-vous le sens artistique », « leur dénierez-vous le sens des affaires de notre pays ? », « nierez-nous notre goût littéraire, notre intelligence et notre sens du style ?16 ».
Par cet exemple, il nous est donc possible de réfléchir aux résistances de certaines institutions vis-à-vis de la relation partenariale (plus que la démarche en elle-même), en raison d’un contexte socio-historique influent. Il en va de même pour le mariage : l’histoire familiale, l’histoire du mariage en lui-même, les traditions, etc., autant de facteurs intéressants à étudier pour la suite de notre recherche entre ses deux concepts, bien plus rapprochés qu’on ne pourrait le penser au premier abord.
Partenariat et mariage : quelle « relation » ?
Il est maintenant temps d’expliciter cette métaphore. Ici, le terme « relation » aurait deux sens :
-
Relation au sens « association » de deux entités, personnes morales. Deux institutions qui fusionnent ou collaborent sous l’égide d’une convention de partenariat.
-
Relation au sens « ensemble » comme pourraient l’être deux personnes physiques qui créent ensemble des affinités, au-delà de l’institution morale précédemment cité. Et donc, au-delà de l’aspect juridique qui encadre ses deux personnes à l’origine.
C’est particulièrement cette deuxième relation qui va nous intéresser dans la partie de cet article (sans toutefois omettre la première relation citée, elle aussi concernée). Maintenant, imaginons la relation partenariale comme une relation de couple qui débouche en finalité sur un mariage : celui de deux êtres heureux qui choisissent de se dire « oui » pour la vie (ou en tout cas sur du long terme), pour le meilleur et pour le pire.
Tout commence par une rencontre, parfois par hasard, souvent sur le lieu de travail ou l’environnement de celui-ci. Parfois par le biais d’un ami en commun (ici, cet ami, c’est « le réseau »). Il arrive même parfois que ledit réseau soit en fait un ami de longue date, avec qui l’on envisage finalement une relation à plus long terme… Au risque que cela complique par la suite les relations professionnelles de chacun, ou que la relation soit si démonstrative qu’elle exclue, inconsciemment ou non, les autres de celle-ci. Jusqu’à créer une forme de dépendance dans la relation entre les deux acteurs, qui auront bien de la peine à s’ouvrir aux autres ou à passer le relais.
Dans tous les cas, les deux acteurs se rencontrent, apprennent à se connaître, se découvrent des valeurs en commun, tissent des liens… Jusqu’à envisager une relation sérieuse et durable. Puis, viennent les fiançailles : la décision de s’engager. Synonyme qu’un cap dans la relation partenariale a été franchi. Et bientôt, l’organisation d’un mariage pour sceller le destin des deux entités. Ce n’est d’ailleurs peut-être pas un hasard si dans le langage courant, le mariage est considéré comme une institution !
Cela nous laisse avec une question en suspens : de quel mariage s’agit-il ?
Mariage arrangé ? Obligé par l’institution et donc, qui n’est pas à l’initiative de ses membres. Il pourrait s’agir ici d’un partenariat imposé par la direction (par intérêt politique, par exemple), et dont les professionnels n’en perçoivent ni le sens, ni l’utilité, mais s’y investissent par obligation, ou pour ne pas décevoir, ni entrer en conflit, avec leur hiérarchie.
Mariage blanc ? Par définition, il s’agit d’une entente qui n’existe que pour tirer avantage de la situation de son partenaire (matériels, médiatiques, financiers comme les subventions…). Et donc, qui n’est pas fondée sur une collaboration mutuelle, ni sur le désir d’une relation partagée. Ce qui peut amener d’ailleurs à des conflits d’intérêts (institution dont l’objectivité et la neutralité peuvent être remises en cause).
Mariage traditionnel ? Avec son lot de spécificités culturelles à prendre en compte comme lors d’un partenariat entre deux associations porteuses de valeurs et coutumes issues de religions différentes (le travail social ayant été fondé sur des fondations profondément religieuses, par des bonnes sœurs, des membres du clergé et autres initiatives et bonnes œuvres de charité, cette question n’est pas anodine). Surtout lorsque les associations en question y sont très attachées et affichent leurs dogmes publiquement.
Mariage « moderne » ? Après la désormais célèbre révolte du mois de mai 1968, il n’est pas rare que les couples envoient « balader les traditions ». Il s’agit alors ici de partenaires qui souhaitent vivre heureux et libres, loin de toute convention classique ou trop contraignante. Des partenaires qui échappent au contrôle de l’institution et qui bâtissent des règles qui leur conviennent, en fonction du contexte dans lequel ils évoluent. Autonomes, ils construisent eux-mêmes leur propre histoire et leurs propres objectifs, à leur rythme. Plus fragiles dans leurs fondations, cependant (plus volages aussi), ils peuvent avoir plus de difficultés à s’inscrire ensemble sur du long terme.
Puis, viennent les premières péripéties dans la relation : les premières périodes de tensions des deux partenaires. L’organisation du « mariage » parfois plus d’un an à l’avance, les premières divergences à ce sujet, la pression des familles, la peur de décevoir le public… En bref, le stress de ne pas réussir « sa » collaboration (qui prendrait ici la forme d’une cérémonie officielle). Une cérémonie au cours de laquelle la signature d’un contrat de mariage peut être décidée. Celui-ci prendrait ici symboliquement la forme d’une convention de partenariat : c’est un document qui n’est pas obligatoire, qui n’a pas de valeur juridique (à l’inverse du contrat de mariage), mais qui protège les deux parties et donne un cadre, sinon, une orientation à leur relation.
Une journée où la projection sur les partenaires est maximale (ce qui pourrait ici, s’apparenter à un partenariat attendu au tournant ou médiatisé voir historique dans l’histoire de deux associations) :
Avec l’idée de mettre en scène sa propre histoire – ce qui nécessite d’aller rechercher de nombreux éléments de son passé –, et de créer un chef-d’œuvre. C’est un bricolage permanent, et tout le monde y parvient. On ne peut simplement pas rater son mariage ; l’injonction de perfection est très forte. Elle nécessite un énorme travail de préparation, qui peut être mal vécu17.
La fête est passée : le quotidien gagne du terrain dans la relation. Et qui dit quotidien, dit une forme de routine qui s’installe. Des moments de bonheur partagés. Des tensions. Puis des conflits. Parfois, des enfants au milieu (ou plus largement, des personnes accompagnées).
Ce qui est déterminant, c’est la communication entre les deux partenaires. Celle-ci est indispensable pour prévenir d’éventuelles crises rédhibitoires dans la relation. Il est alors question d’accepter de faire des compromis, de faire le point sur les attentes de chacun (ce qui est d’ailleurs conseillé avant de s’engager dans la relation, pour éviter les mauvaises surprises !). Car « qui se ressemble s’assemble18 », au moins autant que « les opposés s’attirent ». Cela suppose, pour faire relation, de bien se connaître avant de s’engager. D’avancer ensemble, dans la même direction.
Et surtout, de s’assurer d’avoir des valeurs en commun et d’être impliqués dans une relation d’égale à égale (« cinquante, cinquante », pour reprendre la maxime populaire), afin qu’aucun des deux ne prenne l’ascendant sur l’autre.
Enfin, multiplier les partenaires, est tentant pour répondre à une problématique plus profonde mais, bien souvent, cela a pour conséquence de délaisser la relation entretenue jusqu’alors, ou sans être exclusif (ni même polygame), de s’éloigner des bases qui réunissaient jusqu’ici les deux partenaires. Celui du désir commun.
Après les tensions et les conflits, viennent les non-dits. Puis, d’autres rencontres. D’autres entités qui peut-être ont des valeurs plus proches de ce que recherchent les deux acteurs. Jusqu’à signer la séparation, le divorce, des partenaires, donc la fin du partenariat.
Fin annoncée ou prémonitoire ? Difficile à dire tant cela dépend des partenaires et surtout, des relations de chacun. En revanche, s’il y a bien des éléments de recul que nous avons pour penser et repenser la relation partenariale, c’est bien sur le sujet du mariage et des relations. Qu’en est-il alors plus précisément sur le terrain des pratiques quotidiennes des travailleurs sociaux ?
Le partenariat et le travail en réseau dans le champ des professions sociales
En résumé, il existe des différences fondamentales et caractéristiques bien différentes entre le travail en réseau et en partenariat. Il existe aussi la dénomination d’acteurs interinstitutionnels dans l’accompagnement du public, comme définition alternative. Comment repérer ses subtilités ? Sans pour autant proposer de définitions totalement arrêtées et sachant que nous tâtonnons encore sur ce sujet, voici plutôt des propositions d’élaboration en lien avec le travail médico-social français et ses réalités actuelles de terrain :
Réseau
-
Personnel
Dans un premier temps, le réseau (dans sa pratique professionnelle par le travailleur social) pourrait se résumer simplement comme un « carnet d’adresses personnel ». Par exemple, une amie de lycée devenue boulangère qui accepte de prendre un de vos bénéficiaires du CSAPA en stage pour une période définie. À la fin du stage, chacun retournera à ses fonctions. -
Informel
En restant sur cet exemple précédemment cité, étant donné que votre amie est un contact personnel, vous pouvez la contacter en dehors de vos heures de travail. Peut-être même que vous côtoyez cette personne dans la vie de tous les jours car elle fait partie de votre cercle d’amis personnels (voire de vos proches). Vos relations sont plus libres et moins restrictives que le partenariat. Se pose cependant la question de la distance entre votre vie professionnelle et privée ainsi que votre implication sur votre terrain d’exercice. -
Exceptionnel
Votre amie boulangère vous a rendu service à titre exceptionnel en prenant en stage l’un de vos référés. Son aide était ponctuelle et a été bénéfique plus pour vous que pour elle (de façon générale, trouver un stage est plus difficile pour la personne ou l’institution qui l’accompagne, que pour l’institution qui reçoit et forme des stagiaires, surtout dans un métier en tension). Sauf si l’expérience est concluante et qu’elle accepte de prendre un second stagiaire plus tard. Et avec le temps, pourquoi pas formaliser un partenariat pour assurer la formation de plusieurs « patients » …
Partenariat
-
Mutualisation des compétences
Et donc, la construction d’une relation de confiance pour y parvenir. Les compétences du premier serviront à nourrir l’autre, et inversement. C’est un repas partagé ensemble, avec tout ce que cela implique supposément. Il faut que le partage de compétences/connaissances soit équitable et profite aux deux partis, au risque d’un déséquilibre dans la relation voire d’une dépendance à l’un plus qu’à l’autre, contredisant ainsi l’essence même du partenariat éducatif et mettant en péril le travail avec les personnes accompagnées. -
Formel (conventionné)
Autrement dit, formalisé par une convention. Même si dans la réalité du travail de terrain, cette préconisation n’est pas toujours respectée (après tout, ce n’est pas une obligation légale), la notion « d’encadrement » du partenariat vient consolider le sérieux de la démarche. Les deux partis « s’engagent » dans cette relation, pour le meilleur et pour le pire. -
Notion de durée dans le temps
La temporalité n’est pas la même. Là où le réseau s’apparenterait plutôt à une aventure d’un soir, sans engagement, ici, il est plutôt question d’avancer ensemble dans la même direction, le plus longtemps possible. Pour accompagner le public au mieux. Anecdote tout à fait intéressante sur ce sujet, on appelle d’ailleurs juridiquement le partenariat enregistré (ou PACS19, dans le vocable le plus courant, ou encore « partenariat civil »), une forme d’union civile qui offre aux couples non mariés une reconnaissance légale impliquant tout ou une partie des droits et responsabilités du mariage. Un lien qui vient trouver sens une fois de plus, avec notre sujet de départ…
Finalement, le partenariat et le travail en réseau pourraient se résumer simplement comme suit :
|
Réseau |
Partenariat |
|
|
Forme |
Informel |
Formalisé |
|
Degré d’implication |
Personnel |
Professionnel |
|
Temporalité |
Ponctuel |
Durable |
Enfin, et pour finir avec cette élaboration, reste alors la notion existante mais discrète d’acteurs interinstitutionnels. À comprendre par définition, des personnes qui gravitent autour d’une « relation ou d’interactions entre plusieurs institutions20 ».
Prenons pour exemple une juge des enfants fortement impliquée auprès de jeunes sous main de justice (protection judiciaire de la jeunesse) et leur réinsertion. Elle reçoit régulièrement des jeunes dans son bureau, vient visiter les chantiers d’insertions sur lesquels sont impliqués les jeunes, entretient des contacts très réguliers voir très cordiaux avec les éducateurs de la prévention spécialisée… Pour autant, même si cette personne appartient à l’institution judiciaire (à qui elle rend également des comptes), elle ne saurait représenter l’institution tout entière et porter, à elle seule, la responsabilité d’un partenariat.
Autre exemple, celui de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Il est communément admis de dire qu’elle est partenaire avec les maisons d’enfants à caractère social. Pour autant, autre que sur le plan institutionnel (les professionnels des deux institutions sont obligés de travailler ensemble par la loi du 5 mars 200721, celle du 14 mars 201622 et enfin, celle du 7 février 202223, sans compter celles sur la décentralisation du 7 janvier et du 22 juillet 198324), mais plutôt dans l’expression des pratiques quotidiennes, cette définition pose problème : elle relève davantage de la coordination/référence de parcours que d’une véritable démarche de travail partenariale. Sinon, on peut qualifier l’ASE de donneur d’ordre, ou de service gardien.
Nous pouvons citer aussi à cet effet le médecin d’un centre médical, l’AVS d’une société d’aide à domicile, ou encore l’avocate d’un cabinet juridique… Ce sont des représentants d’une institution, avec qui il nous est possible d’entretenir des liens. Mais leurs investissements à eux seuls ne sauraient justifier la conception et la conduite d’une relation partenariale.
Ce qui nous amène subtilement à un dernier point : la notion de prestation de services. Dans les conversations les plus banales de la vie courante, vous avez probablement déjà entendu maintes et maintes fois que l’argent et le couple ne font pas bon ménage. Que cela finit toujours par créer des problèmes dans la relation. Loin de l’idée de donner raison à cette réflexion, elle a en revanche le mérite d’illustrer parfaitement un frein dans la relation partenariale : l’aspect financier.
La tutrice d’apprentissage d’un étudiant éducateur spécialisé lui avait dit que dès lors qu’on paie un café au partenaire, cette action produit un effet irrémédiable sur la relation future voire l’annihile complètement. C’est une hyperbole, mais cela fait réfléchir : dès lors qu’il existe une transaction entre les deux partenaires, cela n’est plus un partenariat. Cela devient de la prestation de services.
Ainsi, une art-thérapeute, un professeur de musique ou de théâtre en profession libérale (qui représentent donc une institution à eux seuls) viennent animer un atelier directement en CHRS, le font contre rémunération. Ils envoient leur facture à la direction ou au service comptable de l’institution. Ils prennent peut-être beaucoup de plaisir dans leur travail, ont la fibre sociale en eux… Mais ils ne viendront probablement plus assurer leur séance si l’institution décide de ne plus les payer du jour au lendemain. La relation est alors régie par cette question. Et donc, biaisée, sur le plan éducatif.
La meilleure définition du partenariat serait donc basée, au-delà des affinités existantes avec le temps, sur une entraide mutuelle, gratuite et désintéressée. Être partenaire, c’est aussi accepter de quitter une posture de hauteur ou de tout sachant pour s’en remettre à l’Autre, dans une relation de confiance et d’aide en éducation spécialisée25.
Enfin, ce que nous démontre cet ensemble d’exemples, au-delà même de l’étymologie et de la notion pécuniaire, c’est qu’un partenariat (qu’il soit éducatif ou non) ne peut se porter seul. Si la relation ne repose que sur des liens interpersonnels, alors elle n’est pas objective à cent pour cent, menace l’équilibre des deux parties et devient contreproductive pour le public censé en bénéficier.
Aussi, elle représente une charge de travail conséquente pour la personne qui en est à l’initiative (ou qui en est le moteur) et, si cette personne s’absente ou quitte l’institution, le partenariat s’en retrouve alors menacé. Cela peut paraître paradoxal avec les exemples explicités jusqu’ici et la métaphore même du mariage, mais c’est important : si le partenariat est dépendant de la personne qui le porte, alors il est voué à l’échec et en sursis. Pour qu’il fonctionne, il faut que plusieurs personnes soient impliquées et alimentent la relation. Le mariage se fait entre deux institutions (personnes morales), mais c’est tout l’entourage qui porte, ajoute de la valeur et rend solide celui-ci (personnes accompagnées, familles, collègues…). Cela contribue grandement à la démarche éducative de ce partenariat.
Par ailleurs, travailler en partenariat, c’est accepter de rentrer dans un autre univers que le nôtre. Il s'agit d’associer ses forces en toute complémentarité avec une autre institution qui n'a peut-être aucun lien avec notre corps de métier.
Une culture de travail différente, des fonctions totalement opposées… Peut-être même des idées reçues sur les professions sociales. Cela implique alors de prendre le temps de la rencontre : d’expliquer qui nous sommes, notre identité professionnelle profonde, nos missions, nos intérêts communs. Mais surtout, d’apprendre à connaître l’Autre sincèrement, et d’accepter de se laisser entraîner dans son univers, quand bien même il est déroutant et peut bousculer nos pratiques, même les plus résistantes. Un apprenant éducateur spécialisé en jury de certification DC4 avait pu nous raconter une expérience similaire avec l’animatrice d’une radio locale où il avait l’habitude d’emmener les jeunes de la MECS, dans le cadre d’un partenariat bien établi : elle était très autoritaire et très rigide sur le cadre, au sein de son institution, allant à l’encontre d’un positionnement et de pratiques plus souples, que l’éducateur et ses collègues instauraient plutôt habituellement avec le groupe. Dans mes souvenirs, il a pu discuter de cela avec la partenaire en question, afin d’expliquer les enjeux de leur travail au sein de la MECS, avec ces jeunes parfois turbulents, pour des raisons bien spécifiques souvent liées à leur placement. Mais au-delà de cette réalité de terrain, c’est aussi un questionnement tout à fait intéressant qu’il est possible de partager avec ces jeunes : nous ne sommes pas « chez nous », nous allons « chez (la partenaire) ». Elle fixe ses propres règles et assume son propre positionnement, et nous devons nous y conformer. Ou en tout cas, faire ce compromis pour maintenir une bonne entente et la meilleure relation possible. Accepter l’Autre dans sa singularité, même si des idées nous séparent. C’est d’ailleurs l’une des valeurs, sinon, l’un des préceptes du travail en partenariat : l’ouverture vers l’extérieur, dans une perspective d’inclusion et d’insertion dans la société.
Pour conclure, il faudrait pour réussir ce mariage institutionnel, et donc, maintenir une relation partenariale éducative et efficiente, remplir les conditions suivantes :
-
Une relation égale, réciproque et de confiance.
-
Un maximum de communication, sans que cela ne soit trop ou déborde vers des rapports de subjectivités ou trop personnels.
-
Des affinités partagées entre les membres des deux institutions.
-
Accepter la culture de l’autre et se retrouver dans des valeurs communes.
-
Ne pas porter cette relation seul(e).
-
N’avoir ni hiérarchie, ni conflits d’intérêts, ni ascendant dans la relation, chez aucune des deux parties.
-
Ne pas se retrouver au cœur de transactions financières et conserver une dimension socio-éducative la plus pure possible.
-
Que le partenariat s’inscrive dans un principe de durée dans le temps (à durée indéterminée).
-
Avoir recours au partage d’informations (secret partagé).
Sans bien sûr omettre l’évaluation de la relation partenariale et ses bienfaits auprès du public. Au cours de temps informels ou de réunions dédiées, oser se poser les questions suivantes : quels apports supplémentaires dans nos pratiques éducatives auprès du public ? Comment passer d’une démarche partenariale ordinaire à la transformation d’un partenariat à visée éducative ? Ce partenariat est-il toujours pertinent au regard des évolutions du public ?
Ici, le « couple » fait le point. Et ne doit pas rester ensemble par habitude, lassitude, pour préserver un certain confort ou ne pas décevoir la famille, l’entourage proche. Ils doivent se questionner profondément quant à l’intérêt de continuer à évoluer ensemble, pour le bien de la personne accompagnée. Sinon, ils doivent réajuster leur positionnement dans la mesure du possible, et remettre en question leurs pratiques, en tenant compte du contexte et du public qui évolue, en même temps que la société, ses normes et ses événements.
Pour aller plus loin : la famille est-elle un partenaire ?
C'est une question qui revient très souvent dans les oraux de certification DC4 ou lors des entretiens oraux de VAE des professions sociales (éducateurs spécialisés et techniques spécialisés, de jeunes enfants, assistants de services sociaux, conseillers en économie sociale et familiale). Pourtant, il semblerait que ce questionnement fasse débat dans toute la profession, y compris entre les membres du jury eux-mêmes. Cette question ne semble pas avoir trouvé de réponse précise à ce jour.
La dernière partie de cet article, en guise d’ouverture vers d’autres horizons, pourrait servir à proposer une hypothèse de réponse. Dans la continuité des réflexions socio-historiques et contemporaines sur le concept du mariage, la famille apparaît alors comme un acteur essentiel dans sa prise en compte. Pour autant, la famille est-elle indissociable dans une relation partenariale ? Ou au contraire, peut-elle être un frein au plein épanouissement des partenaires ?
À la question : « la famille, est-elle partenaire dans l’accompagnement des personnes ? », en voici quelques réponses :
« Oui, car ils signent le projet personnalisé »
« Oui, car nous ne pouvons travailler sans eux ».
Ces réponses, bien que particulièrement intéressantes, trouvent dans le champ de la protection de l’enfance bon nombre de contradictions : il n’est pas toujours possible de travailler avec les familles qui ne veulent pas s’impliquer. Qui sont contre les travailleurs sociaux, dans la fuite ou violents envers leurs enfants (certains ne savent pas où leurs enfants sont placés et ont l’interdiction de rentrer en contact avec eux, dans le cadre d’affaires judiciaires en attente de procès ou d’une détention provisoire, par exemple). Cela contredit donc la définition du partenariat qui voudrait une réciprocité dans l’accompagnement. Cela ne veut pas dire que les professionnels ne travaillent pas avec les familles lorsque cela est possible, mais que cela ne correspond pas à un partenariat, surtout si les enfants ont été placés pour des négligences ou défaillances diverses et que les familles doivent s’impliquer dans un travail éducatif et de soutien à la parentalité. On parle alors plutôt d’aide contrainte26 pour désigner l’accompagnement d’une famille, par exemple, dans un cadre socio-judiciaire.
De plus, pour qu’un partenariat fonctionne, il faut qu’il tienne sur le long terme. Si les parents s’investissent dans l’accompagnement et la vie de leur enfant et font des progrès concernant leurs problématiques, nous ne pouvons qu’espérer que le retour à domicile soit possible dans de bonnes conditions. Ce qui induirait une fin du partenariat. Comme ont pu l’écrire Cindy Vincente, Anne-Clémence Schom et Philippe Robert, il serait plutôt admis de dire que : « La protection de l’enfance occupe alors la double place inconfortable de tiers séparateur et de substitut parental27. »
Entendu aussi : « Oui, car c’est inscrit comme cela dans le projet d’établissement. »
Ce n’est pas une mauvaise réponse. En effet, en lisant plusieurs projets d’établissements de plusieurs institutions, situées à plusieurs kilomètres l’une de l’autre, sur tout le territoire français, il est possible de constater que la notion de famille et celle de partenaire vont souvent de pair et sont qualifiés ainsi. C’est le cas par exemple de la fondation des amis de l’atelier, l’association des paralysés de France, ou encore la fondation perce-neige, qui ont fondé leur expertise sur l’accompagnement des personnes handicapées et leur famille. À l’origine, beaucoup d’associations existent grâce à la mobilisation de familles militantes et concernées par ce sujet. Dans les conseils d’administration, beaucoup de membres sont des familles de personnes en situation de handicap. Dont certaines ont même un enfant résidant dans l’un des foyers de l’association (c’était le cas par exemple de Michelle Darty, fille d’Hélène et de Natan Darty, fondateurs de l’association du même nom devenue aujourd’hui la protection sociale de Vaugirard, Jean Chérioux).
Comme le cas des institutions accueillant du public sourd, étudié précédemment, l’influence historique est donc claire et se vérifie ici encore. Pour autant, l’essence du travailleur social n’est-elle pas de faire bouger les lignes ? De questionner ce qui est communément admis, et ce, dans l’air du temps ? Sans pour autant déposséder les familles de leur rôle premier d’éducateur (bien au contraire) et toujours dans l’idée de renforcer leur collaboration auprès d’elles, n’est-il pas le moment de leur attribuer un qualificatif plus proche des réalités du terrain ? La question est ouverte et trouvera peut-être une réponse plus claire dans les prochaines législations ou élaborations à ce sujet (dont la reconnaissance des proches aidants comme une expérience professionnelle le 26 juillet 202328 est peut-être une nouvelle avancée sur cette réflexion d’ensemble…).