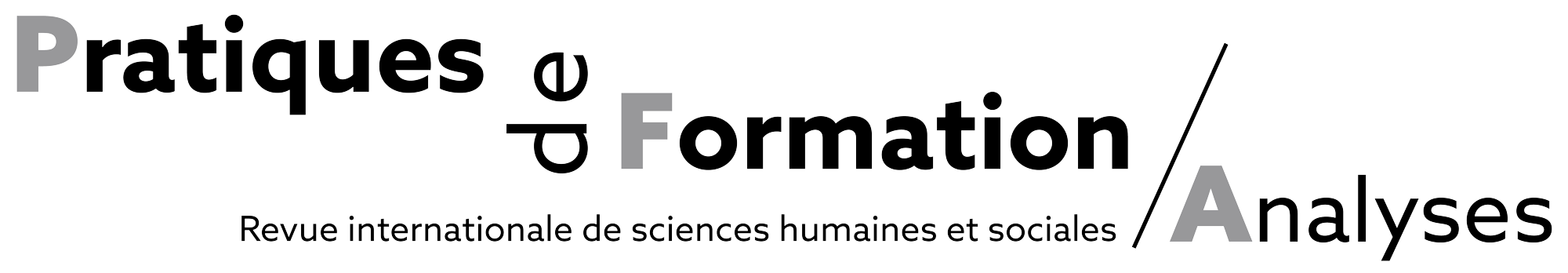Du rapport entre culture technique et éducation1
En décembre 1987, l’Association des enseignants et chercheurs de sciences de l’éducation (AECSE) organisait un colloque intitulé « Culture technique et formation » qui donna lieu à des actes publiés en 19912 et au numéro 17 de la revue Pratiques de formation/Analyses3. L’objectif de ce colloque était de s’interroger « sur la place de la préoccupation technique elle-même, celle d’une sensibilisation aux démarches techniques, à leur imaginaire, leur univers sensible et mental4 », dans les champs de l’éducation et de la formation. On peut y voir un prolongement des réflexions d’après-guerre sur les « humanités techniques5 », dans le contexte de massification scolaire des années 1980, caractérisé par un objectif politique d’accès au bac pour 80 % d’une classe d’âge et la création du baccalauréat professionnel6. La notion de « culture technique » connaît à cette époque un essor dans différents champs disciplinaires au-delà des sciences de l’éducation, en particulier en anthropologie, en ethnologie, en économie, en sociologie et en histoire des sciences et techniques7. Dès 1981, dans son Manifeste pour le développement de la culture technique8, Jocelyn de Noblet appelait de ses vœux une reconquête de la technique alors considérée comme subalterne et selon l’auteur morcelée en spécialités où « chacun vit sur un bastion avec son vocabulaire et ses usages et, faute de culture commune, ne peut communiquer avec les autres9 ». Développer la culture technique correspond pour lui à la nécessaire réappropriation de la technique par la population tout entière, dans la perspective de la « nouvelle citoyenneté » promise par le gouvernement socialiste français de l’époque.
« Culture technique » : cette terminologie est actuellement moins présente dans la littérature scientifique. Les anthropologues parlent de « culture matérielle », considérant que la relation physique des humains aux objets fait culture10. D’autres termes sont préférés ailleurs dans des sens plus restreints ou qui se recouvrent partiellement : « culture numérique », « culture digitale », « littératie numérique », par exemple, concernent les usages des équipements numériques connectés. Le vocable de « culture technique et industrielle » est utilisé dans les discours politiques11 de manière subordonnée à la notion de culture scientifique, dans une vision positive de l’innovation.
Comme d’autres12, nous souhaitons aujourd’hui interroger à nouveau la notion de « culture technique » de manière interdisciplinaire, et participer à l’actualisation des questions relatives aux rapports entre culture technique et éducation. Nous partons de l’hypothèse que vivre dans la société technicisée requiert, au-delà de la maîtrise de gestes techniques liés à l’utilisation et la création d’objets ou d’outils, une compréhension élargie des processus sociotechniques dans lesquels ces pratiques et ces objets sont insérés. Ainsi, la culture technique représente des enjeux fondamentaux d’éducation et de formation tout au long de la vie.
En effet, une première conception de la culture technique concerne l’individu, dans sa capacité d’agir et dans son rapport au monde et aux autres. Est-il en mesure de s’approprier les objets techniques comme moyen d’action pour ses propres fins, ou de choisir de ne pas les utiliser ? Dans sa relation de communication avec eux, dispose-t-il de la culture technique que Gilbert Simondon appelait de ses vœux dans les années 1950, c’est-à-dire d’un « ensemble de formes qui, rencontrant les formes apportées par la machine, pourront susciter une signification13 » ? Par ailleurs, avons-nous conscience des interactions invisibles et des rapports de pouvoir dans lesquels nous sommes engagé∙es par l’intermédiaire de ces objets, en particulier lorsqu’ils sont informatisés et connectés14 ? En mesurons-nous les conséquences potentielles pour nous-mêmes et pour les autres ? Savons-nous protéger nos données personnelles des utilisations frauduleuses ou à des fins d’enrichissement et de capitalisation ?
La culture technique peut aussi être conçue comme une condition d’accès et de participation active à une société démocratique. La capacité d’utilisation des équipements informatiques et une compréhension des procédures administratives dématérialisées deviennent de fait un préalable à l’accès autonome aux droits sociaux et à l’exercice de la citoyenneté15. La participation éclairée de tous les citoyens et de toutes les citoyennes aux choix de société est conditionnée par un minimum de culture technique partagée, par exemple au sujet des infrastructures techniques communes de production d’énergie, de transformation des déchets, de transport, etc. Au-delà de prises de consciences individuelles qui peuvent conduire à des changements de comportements plus écoresponsables, quelles sont les conditions de réalisation effective d’une délibération citoyenne, en termes d’enjeux et de risques pour l’environnement et la durabilité de l’espèce humaine, indépendamment des intérêts économiques privés ? Ainsi posée, la culture technique constitue un enjeu de souveraineté populaire technique16.
Enfin la culture technique comme rapport aux outils, aux instruments, aux machines s’inscrit d’une manière plus large dans des rapports au travail, à la nature et à la matière. L’industrie continue de s’automatiser, avec une présence accrue de l’intelligence artificielle et des objets connectés, en ce qui concerne les procédés de fabrication et les produits eux-mêmes. S’y développe une gestion informatisée et centralisée des données sur les produits (on parle de « jumeau numérique » du produit), de leur conception à leur mise sur le marché, puis lors de leur utilisation, leur maintenance et leur destruction, ces données devant être créées, consultées, enrichies par des acteurs multiples, sur des temps longs17. Les compétences techniques des professionnel·les sont mobilisées de manière inédite en interaction avec d’autres savoirs : la maîtrise des processus de production automatisés (« work process knowledge18 »), la maîtrise des interfaces humain-machine, le repérage dans un système organisationnel et informationnel complexe, etc. D’autres pans d’activités économiques sont concernés par des changements comparables, comme l’agriculture, touchée à la fois par une tendance à la robotisation, par la redécouverte des processus biologiques systémiques, mais aussi par un mouvement d’écologie industrielle et territoriale, en réponse aux problématiques énergétiques et de développement durable19.
Ces considérations sur les sens d’une culture technique en société doivent nous conduire à questionner la nature des savoirs en jeu et les processus de leur transmission ou de leur apprentissage. Ainsi la place des sciences humaines et sociales (SHS) dans la formation des ingénieurs a fait l’objet de nombreuses réflexions. C’est par exemple l’une des préoccupations à l’origine de la réforme de l’École des mines de Nancy en 195720, dans l’objectif de prendre en compte des situations d’activités qui intègrent des prescriptions organisationnelles et sociales. Dans le même esprit, des enseignants-chercheurs en universités technologiques21 développent une « recherche technologique en sciences humaines et sociales », qui, dans une approche pluridisciplinaire, prend pour objet la dimension sociotechnique de l’expérience humaine. In fine, l’ambition est d’offrir aux élèves ingénieurs « des outils conceptuels et des méthodes qui puissent les aider, comme technologues et comme citoyens, à participer à la construction d’un environnement socio-économique en devenir. Et pour cela, elle doit introduire les étudiants à une dynamique de recherche en SHS (et non pas délivrer des savoirs prétendument achevés)22 ». Il s’agit ici de les préparer au travail de l’ingénieur, qui ne conçoit plus seulement des dispositifs techniques, mais des situations d’activités qui intègrent des prescriptions organisationnelles et sociales, des schémas d’usage empreints d’idéologies particulières de la technique. L’introduction à une démarche de recherche en SHS doit leur permettre de développer une posture critique dans la constitution de ces nouveaux objets sociotechniques.
Mais la promotion d’une conception élargie de la culture technique en éducation et en formation ne doit pas être aveugle à l’importation des rapports sociaux sur laquelle elle est construite. Analysant l’histoire de la formation initiale des techniciens et ouvriers en France de la fin du xixe siècle jusqu’aux années 1970, Bernard Charlot23 montre le décalage qui existait entre les discours ambitieux sur une culture technique pour le technicien et l’ouvrier, et les objectifs précis des formations. En effet, selon lui, tandis que dans le discours politique la « technologie » était présentée comme une théorie raisonnée des métiers permettant un accès aux plus hautes fonctions de l’esprit, sur le terrain de la formation, la culture technique de l’ouvrier, qui n’aurait pas le goût de l’abstraction, relevait exclusivement du « concret ».
La dissociation du concept et de l’acte a rendu possible l’idée d’une culture technique ; mais elle repose sur des rapports sociaux hiérarchisant les individus selon un axe conception-exécution. Les ouvriers, rejetés du côté de la simple exécution, sont censés ne participer à la culture technique qu’au niveau de la matérialité des choses, du manuel, du sensoriel. Mais définir ainsi une culture par la référence au concret, c’est en écarter d’emblée ce qui dans la culture fait sens et véhicule du sens24.
Il s’agirait, selon Bernard Charlot, d’une « pseudo-culture technique ». Il faut nuancer ces constats car, même si les ingénieurs ont inventé l’organisation scientifique du travail, participant ainsi à la dépossession des savoirs ouvriers, ils sont aussi parmi les principaux promoteurs d’une éducation ambitieuse des ouvriers. Ainsi, en France, ils sont à l’origine des premiers cours gratuits au Conservatoire national des arts et métiers à partir de 1824 (cours de Charles Dupin)25 puis, après 1830, de ceux de l’Association polytechnique parisienne.
Les formations de baccalauréat professionnel d’aujourd’hui peuvent aussi être interrogées sous cet angle des rapports sociaux. Ainsi, mettant en relation l’insertion professionnelle de titulaires de bacs professionnels et les référentiels de diplôme, Henri Eckert26 montre que les finalités d’apprentissages techniques se présentent comme étant au service de la transmission d’un ethos professionnel empreint de l’idéal de flexibilité attendu par les entreprises.
Plus généralement, le développement d’une culture technique et son analyse se confrontent à des difficultés, bien connues depuis longtemps27, mais qui se sont accentuées aujourd’hui. La première des difficultés est liée à la complexité des dispositifs techniques eux-mêmes, et à leur intrication dans des réseaux techniques, organisationnels et informationnels, dont les fonctionnements ne sont pas visibles et même très difficiles à conceptualiser. La deuxième est celle de la confiscation du savoir par les langages de plus en plus spécifiques et reliés au cadre de leur usage, d’une part, par les chercheurs et ingénieurs dans leurs disciplines respectives, et d’autre part, par les acteurs des secteurs professionnels. Ce phénomène est accentué dans un contexte concurrentiel international, où l’information technique est protégée et sort difficilement des entreprises industrielles. Cela soulève la question des langages fonctionnels susceptibles de permettre la communication interdomaine, entre experts et profanes et entre concepteurs et usagers. Les analyses de communautés techniques horizontales, ouvertes et de démocratisation de la technologie sont intéressantes de ce point de vue (fablab, « do it yourself [DIY] », communautés en ligne…)28. Une autre difficulté est liée à l’évolution très rapide des technologies et à leur diffusion en société selon des processus différenciés dans les différents champs d’activité. Ces transformations techniques et technologiques, incessantes et accélérées29, concernent en particulier le monde du travail. Par conséquent, les besoins de formation changent rapidement, afin de développer et de maintenir les aptitudes professionnelles des individus et des collectifs. Qu’est-ce que ces nouvelles articulations entre le monde du travail et le monde scolaire et de la formation impliquent-elles comme changements ? Quelle est l’influence des stratégies gouvernementales ? Dans quelle mesure les systèmes de formation sont-ils adaptés à la formation en vue de l’exercice de métiers sans cesse changeants ? Comment appréhender les transmissions effectives de savoirs et, à l’opposé, les processus d’exclusion par la non adaptation des environnements techniques aux personnes ? Comment les professionnels de l’éducation et de la formation s’adaptent-ils ou participent-ils de ces processus ?
Présentation du dossier
Le dossier thématique de ce numéro 71 de la revue Pratiques de formation/Analyses explore la notion de culture technique sous de multiples dimensions. En croisant approches théoriques et analyses de terrain, les contributions rassemblées ici interrogent la définition des pratiques et des savoirs techniques et technologiques, mais aussi leur transmission, les pratiques éducatives associées et les enjeux socioculturels sous-jacents.
Un premier axe de réflexion porte sur l’analyse de dispositifs d’éducation informelle et de formation professionnelle, interrogés sous l’angle des finalités éducatives.
Lucie Cuvelier, Marion Paggetti et Solveig Fernagu examinent l’introduction, dans la formation des ingénieur∙es, d’un jumeau numérique, sorte de double digital d’un système technique physique (en l’occurrence celui d’une petite chaîne de production), permettant de centraliser et de rendre accessible l’information sur ce système. Leur analyse met en évidence la double fonction de cette technologie en contexte de formation initiale, celle-ci étant initialement développée en contexte professionnel dans l’industrie. D’une part, le jumeau numérique constitue un médium innovant pour la découverte et l’analyse technologique d’une chaîne de production industrielle, en offrant l’expérience immersive et interactive d’une usine virtuelle. D’autre part, elle est un levier pour l’initiation à la structure et aux principes d’usage d’un jumeau numérique en contexte professionnel. Les autrices montrent que les objectifs d’apprentissage des concepteur∙rices pédagogiques et des enseignant∙es fluctuent entre ces deux pôles, ce qui crée des troubles chez les apprenti∙es ingénieur∙es. Elles se demandent finalement si la représentation numérique, forcément sélective, ne serait pas un obstacle au développement d’une culture technique, à cause de l’illusion de non-médiation.
Clément Calmettes analyse les tensions à l’œuvre dans l’enseignement des techniques de pêche en lycée professionnel maritime. Son article met en lumière les contradictions entre une transmission technique standardisée et la réalité des pratiques professionnelles, qui exigent une grande adaptabilité. Il insiste sur l’importance, dans un contexte de forte évolution, de développer l’autonomie des élèves et leur capacité à participer aux dialogues de la profession avec les scientifiques, les politiques et les administrations et de veiller à l’articulation des connaissances professionnelles et des savoir-faire locaux.
De son côté, Arnaud Loustalot interroge le rôle du travail manuel dans les chantiers internationaux de jeunes, espaces de volontariat où se croisent des participants issus de cultures diverses. Il souligne que ces chantiers, bien que souvent perçus comme des expériences de découverte et d’échange, sont aussi potentiellement des lieux d’apprentissages techniques implicites. L’article montre que ces activités de chantier participent d’une éducation informelle, où le travail manuel semble davantage servir à structurer la vie collective et à encourager l’engagement citoyen qu’à transmettre un véritable savoir-faire technique. Les apprentissages techniques apparaissent ainsi comme un « impensé éducatif » dans le projet des associations de chantiers de jeunes, davantage tournées vers des objectifs sociaux et culturels que vers une réelle formation au travail par le travail.
Un deuxième axe interroge la définition même et la portée de la culture technique et leurs implications dans les contextes éducatifs.
Thierry Lefort adopte une approche anthropologique et plaide pour la reconnaissance de la technique comme une forme autonome de rationalité humaine, distincte des simples usages d’outils ou d’artefacts. Selon l’auteur, cette capacité d’abstraction place la technique au même niveau que le langage ou le droit en tant que fondement de la culture humaine. Il défend l’idée que la culture technique ne se réduit pas à une maîtrise instrumentale, mais qu’elle engage une capacité d’analyse et d’innovation propre à l’humain. Son article met en perspective cette approche avec des traditions philosophiques, ouvrant un débat sur la place de la technique dans l’évolution des sociétés.
Cette perspective est enrichie par un entretien avec Isabelle Collet, qui aborde la question du genre dans la culture technique et numérique. Elle met en évidence les biais de genre intégrés dans les technologies, notamment par le prisme de la conception genrée des objets et des systèmes numériques. Son analyse aborde également la masculinisation progressive de l’informatique comme domaine d’expertise, qui a conduit à l’exclusion des femmes malgré leur présence initiale dans le développement de la programmation. Elle insiste sur la nécessité d’intégrer une approche de genre dans la formation des enseignant∙es et dans les politiques éducatives, afin de lutter contre ces inégalités structurelles.
Pour sa part, Georges-Louis Baron analyse les transformations induites par l’usage croissant des outils numériques dans le métier d’enseignant, questionnant par-là la culture technique de l’enseignant∙e en lien avec les visées d’éducation des élèves. Le numérique recouvre trois aspects distingués par l’auteur : la technologie éducative, l’utilisation d’instruments logiciels dans les disciplines, l’enseignement et l’apprentissage de savoirs informatiques. Portant un regard sur la place du numérique dans le système éducatif français depuis les années 1970, il rend compte des interactions entre les différents acteurs des processus d’innovation, de diffusion et d’appropriation progressive des technologies numériques par le corps enseignant : enseignant·es pionniers et pionnières, chercheurs et chercheuses en éducation, organes institutionnels.
Un troisième axe qui apparaît dans ce dossier concerne les langages, les outils de médiation et plus largement les interactions sociales autour de l’objet technique, appréhendé dans leur complexité, et intervenant dans les processus de développement et de transmission d’une culture technique. Ainsi, nous l’avons vu, l’article de Lucie Cuvelier, Marion Paggetti et Solveig Fernagu, interroge les propriétés pédagogiques et montre les obstacles de la représentation numérique en trois dimensions permise par le jumeau numérique. Clément Calmettes, pour sa part, rend compte des limites du langage et particulièrement de la sémantique propre à chaque discipline ou culture technique particulière, dans les situations de formation aux métiers de la pêche. Si les différences de dénomination semblent être a priori un frein à l’apprentissage, elles nous disent aussi la richesse des interactions, rendues possibles par la mise en œuvre par l’enseignant d’un environnement d’apprentissage ouvert à la complexité. Ces interactions font partie de la culture technique par le vocabulaire répertorié et défini, utilisé et associé à des objets, à des situations professionnelles, mais aussi par l’échange entre les acteurs qui, au-delà d’une verbalisation, développe une socialisation spécialisée autour de savoir-faire techniques et, tout simplement, des relations sociales. Cette socialisation autour du geste professionnel est au cœur de l’article d’Anaïs Bloch. En effet, dans le cadre d’une recherche anthropologique auprès de réparateurs de smartphones, Anaïs Bloch a utilisé le dessin pour matérialiser ses observations des acteurs en situation professionnelle. La bande dessinée, comme cela se fait aussi à travers la vidéo, est ici un moyen efficace de restituer la complexité des chaînes opératoires, tout en la rendant accessible aux acteurs rencontrés sur le terrain. Plus que d’autres supports cependant, elle favorise l’échange avec les professionnels observés. Son geste de dessinatrice-chercheuse se constitue en même temps que celui du réparateur observé. Du dialogue, rendu très interactif par cette superposition, émerge une explicitation négociée constitutive en elle-même d’une culture technique accessible à tous et valorisante pour les acteurs. Cet article montre ainsi que la culture technique est enrichie par des échanges intercatégoriels et une communication ouverte, notamment scientifique. Technique, mais aussi dialogique, elle a toutes les dimensions d’une culture.
En définitive, ce dossier propose une analyse nuancée et pluridimensionnelle de la notion de culture technique. Il croise différentes approches et interroge ses dimensions éducatives, anthropologiques et sociales. Il invite à considérer la place de la technique dans la transmission des savoirs et la construction du commun. Il met en exergue les spécificités de la formation aux savoirs techniques et aux postures liées à la culture technique. Ce faisant, il explore de nouvelles approches pédagogiques, tenant compte des dynamiques de pouvoir et des inégalités persistantes. Plus qu’un ensemble structuré de savoirs et de compétences, la culture technique est conçue comme permettant une participation active et lucide au monde : elle traverse et est traversée par ce qui est commun aux sociétés, bien au-delà de la seule maîtrise du geste technique ou d’un champ de connaissances spécifique. C’est notre rapport aux savoirs qu’elle questionne ; nos usages, nos pratiques, notre environnement technique qu’elle redimensionne ; notre conception de la formation qu’elle élargit.