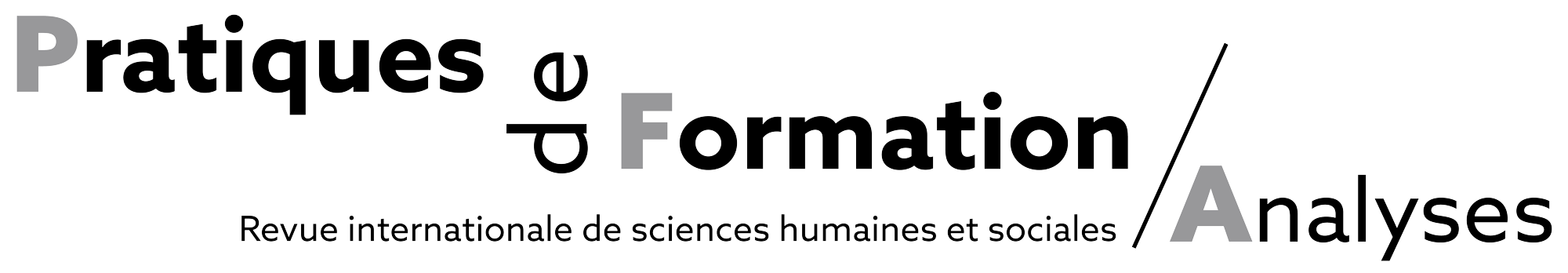Photo de Georges-Louis Baron
Georges-Louis Baron est professeur émérite en sciences de l’éducation et de la formation au laboratoire EDA, à l’université Paris Descartes. Après des études en mathématiques il devient enseignant de mathématiques, se forme en informatique. Il commence la recherche en éducation en tant qu’enseignant associé à l’INRP au milieu des années 1970 et développe une expertise dans la recherche participative avec les enseignants. Il s’intéresse principalement à la constitution de l’informatique comme fait éducatif et à l’histoire des technologies éducatives et de leurs usages dans l’univers scolaire depuis les années 1960.
Michaël Huchette. Merci Georges-Louis de nous accorder cet entretien, pour aborder la question de la culture technique dans le métier d’enseignant, sous l’angle du numérique. Tu étudies depuis longtemps l’informatisation de l’enseignement scolaire. En quoi, selon toi, ce phénomène a transformé le métier d’enseignant ?
Georges-Louis Baron. D’abord, une remarque. Je ne pense pas qu’il y a eu une informatisation de l’enseignement scolaire. Il y a plutôt eu un recours croissant à des instruments et des méthodes informatiques, à des instruments de traitement de l’information et cela a eu des effets non négligeables sur le système éducatif, changeant des gestes professionnels, complexifiant les situations didactiques traditionnelles et exigeant de la part des enseignants une nouvelle technicité.
Je me suis surtout intéressé à la mise en œuvre de l’informatique (on tend plutôt maintenant à parler de « numérique ») dans l’éducation et plus particulièrement dans l’enseignement scolaire. Cela est à resituer dans le domaine plus vaste de ce qu’on a appelé les technologies de l’information et de la communication.
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une série de vagues de ces technologies qui ont très tôt fait l’objet de politiques publiques en éducation : l’audiovisuel et la télévision, l’informatique, ce qu’on a appelé les autoroutes de l’information, la télématique, Internet… Et maintenant l’intelligence artificielle générative. Pour chacune sont apparus des prophètes de la modernité, des imprécateurs, des innovateurs, puis des marchands.
Pour être précis, il faut y distinguer trois grandes dimensions, comme on l’a analysé avec Éric Bruillard il y a assez longtemps. La première est la technologie éducative : on supplémente l’action enseignante par des technologies. Il y a ensuite l’utilisation d’instruments logiciels (tableur, traitement de texte, dessin assisté par ordinateur, production assistée par ordinateur, etc.) qui permettent d’apprendre des disciplines existantes. Et puis, il y a l’apprentissage de nouveaux savoirs, qu’ils soient liés à la pensée informatique ou à des questions techniques. Ce n’est pas du tout la même chose. Je vais développer un peu chacun de ces trois domaines.
Le cas de la technologie éducative a bien été documenté, en particulier par Larry Cuban. Dans ce domaine, qui relève des méthodes pédagogiques, les vagues viennent et refluent. Lors de la vague suivante, on trouve que la précédente n’était pas si intéressante et on espère que la nouvelle sera mieux. Il ne s’agit cependant pas d’une malédiction de l’éternel retour : certaines innovations s’installent durablement (les quizz par exemple ou les ressources en ligne).
La deuxième dimension, c’est l’utilisation de nouveaux instruments logiciels qui n’ont généralement pas été conçus au départ pour l’éducation (il y a donc eu à leur égard des entreprises de didactisation). Il s’agit de systèmes de gestion de bases de données, de tout ce qui est lié au traitement de textes, aux tableurs, à l’expérimentation assistée par ordinateur, aux logiciels de dessin assisté par ordinateur… Dans ce cas, des formes de scolarisation se sont produites.
Troisième et dernière dimension : l’apprentissage de l’informatique, qui amène à enseigner de nouveaux concepts et de nouvelles pratiques. Cela est allé très vite pour la discipline universitaire, puisque des maîtrises d’informatique ont été créées dès 1967. L’idée d’enseigner l’informatique dans le second degré, d’abord mise en œuvre dans les secteurs techniques, a été sérieusement considérée dans la formation générale dès le début des années 1970. Mais il s’est écoulé 50 ans entre cette idée et la création effective d’une discipline scolaire. Dans le second degré, l’initiation à l’informatique s’est longtemps uniquement faite par les disciplines existantes. Cela a bien été documenté par la recherche.
Finalement les technologies de l’information n’ont pas à elles seules transformé le métier d’enseignant. Mais des changements importants ont eu lieu au cours du temps en éducation, et ils ont largement été inspirés par des innovations conduites par des enseignants qui ont mis à l’épreuve des solutions possibles.
M. Huchette. Selon toi en quoi les vagues que tu mentionnes font-elles évoluer le métier, la professionnalité des enseignants. Est-ce qu’il faut nuancer cette question de la professionnalité enseignante qui évolue ? Quel est ton point de vue sur cette question ?
G.-L. Baron. Je pense qu’il vaut toujours mieux nuancer, puisque les choses sont généralement plus compliquées qu’elles ne semblent au premier abord. Ce ne sont pas les vagues techniques à proprement parler qui ont fait évoluer le métier, mais la profession qui s’est approprié les technologies, sans pour autant provoquer de bouleversements très notables. À chaque nouvelle vague, il y a eu des secteurs d’innovation très dynamiques, soutenus par le ministère, en particulier dans le second degré, qui ont joué un très grand rôle d’invention et de mise à l’épreuve d’idées et de produits.
Il y a eu une sorte de perméabilité entre recherche et innovation. Par exemple, dans les années 1970, l’INRP a été associé à la première opération, dite des 58 lycées, d’introduction de l’informatique au lycée. Des enseignants ont très tôt été formés et amenés à réfléchir à ce que pouvait être l’informatique pour apprendre, des établissements ont été équipés et il y a eu création d’une première base de logiciels éducatifs. Certains de ces logiciels ont été utilisés pendant très longtemps, autour de la simulation, autour de bases de données, voire autour d’exercices programmés, de manières de penser la transmission de tel ou tel domaine. Toutes les innovations, bien sûr, n’ont pas eu de postérité. Les évolutions du métier se sont produites par une série d’héritages indirects à partir d’actions menées bien en amont avec des enseignants et soutenues par des pouvoirs politiques.
Ainsi, dans le domaine des sciences expérimentales, on commence à réfléchir dès les années 1970, sur la simulation et la modélisation, en particulier autour de Jacques Hebenstreit et des travaux qu’il a menés à l’INDRP avec des enseignants. Quand on a eu des micro-ordinateurs avec des capacités graphiques et la possibilité de traiter des signaux entrants, on a commencé à développer l’expérimentation assistée par ordinateur.
Il y a eu des pionniers au CNAM et à l’INRP qui ont inventé des capteurs, des interfaces, des logiciels permettant de nouvelles manières d’étudier des phénomènes physiques et biologiques. Leurs recherches ont suscité beaucoup d’intérêt. Des fabricants de matériels didactiques ont trouvé cela intéressant et ont mis des produits sur le marché. Puis il y a un moment où l’Inspection générale de l’Éducation nationale a donné son appui. Et puis finalement, l’expérimentation assistée par ordinateur (EXAO) s’est scolarisée doucement.
Mais il y a aussi eu des obstacles. Par exemple, si l’EXAO a été considérée au début comme permettant d’adopter une attitude de recherche vis-à-vis des phénomènes physiques et biologiques, en pratique cela s’est révélé plus compliqué. Il y a en effet des conditions pour que cela marche en classe (les équipements doivent être en nombre suffisant, les programmes scolaires doivent favoriser ce type d’approche, les enseignants doivent avoir été formés…). On a constaté qu’il est indispensable, dans un cadre scolaire, d’essayer de limiter les possibilités d’erreur pour les élèves, et on a didactisé les instruments, ce qui les a rendus plus abordables mais a limité la marge de manœuvre des élèves. La scolarisation qui s’est produite n’est pas tout à fait ce qu’avaient imaginé les premiers promoteurs.
Ceci dit, il n’y a pas que les aspects techniques. Je suis frappé par le phénomène des formations à distance, qui s’est certes développé parce qu’il y avait des instruments pour cela. Mais il y a eu accélération lors de la crise du COVID.
Yannique Delabos. Quels objectifs peut-on allouer à l’usage scolaire de l’informatique ou à l’enseignement informatique ? Est-ce que c’est de former un nombre limité de personnes expertes dans le domaine, ou bien avoir des jeunes qui vont être adaptés au monde dans lequel ils vont travailler dans une société qui évolue, ou encore est-ce un objectif plus général de démocratisation de l’enseignement par l’utilisation des outils informatiques dans l’enseignement ? Quel est ton point de vue sur la question ?
G.-L. Baron. C’est une bonne question mais à laquelle seules les autorités politiques peuvent apporter une réponse pratique. Cela a dépendu des époques.
En 1970, quand le ministère français a lancé des opérations d’introduction de l’informatique, il y avait une vision, celle de ce que ce qu’on a appelé la démarche informatique, ce qu’on a appelé plus tard la pensée informatique, considérée comme susceptible de jouer un rôle dans toutes les disciplines et de renouveler l’enseignement.
Il fallait pour cela former des professeurs de toutes les disciplines. Le ministère a lancé des formations dites « lourdes » pendant un an, à mi-temps ou à plein temps pour un nombre limité d’enseignants (500 environ ont été formés ainsi de 1970 à 1976). Et puis, il y a aussi eu la mise en place de formations « légères », à distance. Cela a eu un véritable effet lors de la phase de développement, d’extension, qu’on a vue à partir de 1979-1980, et qui a connu une certaine réorientation lors de l’alternance politique de 1981.
Le pouvoir politique, à cette époque de diffusion des micro-ordinateurs, considérait l’informatique comme quelque chose de nécessaire pour tout le monde. Il a accordé jusqu’en 1985 une priorité à des formations approfondies d’enseignants et aussi à des actions plus courtes dans le cadre de plans académiques de formation. Ces investissements en formation étaient alors aussi élevés que ceux en équipements. Il n’y avait alors pas encore beaucoup de foyers qui avaient des ordinateurs personnels, mais des outils informatiques d’usage général avaient déjà été développés.
C’est aussi en 1981 qu’on a créé, d’abord à titre expérimental, une option informatique au lycée. L’idée, était de la rendre accessible à tout le monde. Mais il n’y avait pas les moyens de l’enseigner largement. La demande était forte. Au maximum, l’option informatique a concerné environ 60 % des lycées, mais avec des effectifs assez faibles.
M. Huchette. C’était une option au baccalauréat ?
G.-L. Baron. Non, pas tout de suite. Mais cela a très tôt été une revendication. L’option était enseignée par des enseignants de différentes disciplines, qui avaient été formés en informatique. À partir du moment où il y a eu une épreuve au bac (je crois que la première a eu lieu en 1985 ou 1986), elle a très vite rétroagi sur le contenu de l’enseignement. On s’est rendu compte en particulier que les élèves du technique réussissaient moins bien que les élèves du général et, en fait cette option s’est davantage développée dans les lycées généraux où on a donc sélectionné des élèves de bon niveau. Le ministère demandait que cette option soit ouverte à tous, mais en fait, c’est devenu une sorte de super série scientifique. Finalement, comme cela coûtait cher en formation continue des enseignants, l’option a été supprimée à la fin de la décennie sous le ministère Jospin.
C’était d’ailleurs logique de la part de l’administration : une inflexion importante avait eu lieu en 1985, lorsque le Premier ministre Laurent Fabius avait lancé le plan informatique pour tous et qu’il a parlé pour la première fois d’outil informatique, au singulier, appellation globalisante pour désigner les progiciels1. C’était commode cette idée d’outil informatique, qui se banalise et ne nécessiterait pas de formation approfondie. Du coup, apprendre l’informatique pour tous n’était plus considéré comme nécessaire. Les priorités avaient changé.
Cela a évolué à partir de 2000, quand il est apparu que, finalement, il y avait des choses à apprendre, des compétences à acquérir (mais pas encore des contenus à enseigner). Et c’est alors qu’on a créé le B2I, brevet informatique et internet. L’idée, c’était que tout le monde devait l’obtenir, en collège et en lycée. Puis il y a eu le C2I, certificat informatique et internet, dans le supérieur, que les futurs enseignants devaient passer. Mais dans la pratique, cela a plus ou moins bien fonctionné.
Une nouvelle inflexion s’est produite après 2010, quand les décideurs se sont rendu compte que l’informatique devait être enseignée en milieu scolaire. Un rapport en ce sens de l’Académie des sciences de 2013 a eu de l’écho. Des enseignements ont été créés en lycée et un CAPES et une agrégation ont été instaurés en 2020 et 2021, avec un nombre assez limité de postes.
On bute toujours sur le problème qui a été signalé par Yannique Delabos, c’est-à-dire que c’est très difficile de créer un enseignement pour tout le monde. Il est bien plus facile de mettre en place un enseignement de spécialité.
Il y a eu d’autres opérations relatives à l’enseignement de contenus liés à l’informatique, et je pense en particulier avec émotion à Jean-Louis Martinand et aux actions qu’il a promues dans les années 1980. Les programmes de technologie au collège ont alors pris en compte l’informatique, ce qui a joué un rôle très important pour donner aux jeunes des notions sur ces questions-là. Ce nouvel enseignement était au début assuré par les anciens PEGC voie 132 qui ont suivi des formations complémentaires. En technologie, l’informatique a été théorisée comme une discipline où l’information est une matière d’œuvre. C’est-à-dire qu’on peut finalement la travailler, la couper, la coller, etc., faire des choses avec. Cela correspondait à une orientation politique qui a ensuite été abandonnée.
Au fil du temps, l’idée qu’il n’y a pas besoin de former les jeunes, puisque « de toute façon ce sont des indigènes numériques, ils sont nés avec l’informatique, donc ils savent agir », est apparue comme erronée. Il faut bien que les enfants apprennent. Ils peuvent le faire dans leur famille, par interaction avec leurs pairs et par le système scolaire. Si ce dernier ne transmet pas, il y a une situation d’inégalité.
Je pense en particulier au travail de thèse de Cédric Fluckiger3, qui s’est fait embaucher comme surveillant dans un collège et qui a analysé ce qui se passe. Il a documenté le rapport des jeunes à l’informatique, montrant que certains ne savaient pas conceptualiser les processus qui se produisent. Et ceux qui le savaient, c’est parce qu’ils l’avaient appris en cours de technologie, justement. Donc, en fait oui, il faudrait effectivement que l’informatique arrive à tout le monde. Mais c’est assez compliqué à mettre en œuvre et il faut bien convenir qu’il y a un déficit de formation des enseignants dans ce domaine-là.
M. Huchette. On voulait justement parler de la formation des enseignants sur ces domaines. Tu as expliqué que selon les époques, il y avait différentes conceptions de l’informatique et de sa place dans le monde scolaire. On peut donc imaginer que cela influence la manière de concevoir la formation des enseignants aussi. Et tu as mentionné des apprentissages informatiques hors institution scolaire. On pourrait se dire que les enseignants aussi ont des savoirs, ont acquis des compétences hors de la formation institutionnelle ? Comment la recherche peut analyser cela ?
G.-L. Baron. Dans le second degré, les enseignants des disciplines scientifiques et techniques ont maintenant fait de l’informatique dans leurs études, généralement ils savent programmer, ce n’est pas dire qu’ils savent tout, mais ils ont une technicité qu’ils peuvent mettre au service de leurs intentions pédagogiques. Ce n’est cependant pas un cas général et il y a un véritable problème, en particulier dans le premier degré.
Évidemment, désormais il y a des ressources sur Internet. Il se passe d’ailleurs un phénomène assez intéressant. Le ministère français est beaucoup intervenu, en particulier par ses structures déconcentrées, dans les académies, il a investi dans la création de sites avec des ressources. Mais cette offre n’est pas la seule. il y a bien sûr ce qui provient du privé, et il y a un secteur assez actif, qui est celui des communautés de praticiens, sur lequel on a travaillé au sein d’un projet piloté par Éric Bruillard intitulé Révéa4, projet sur les ressources vivantes. Il se passe des choses vraiment intéressantes.
Déjà au début des années 2000 Béatrice Drot-Delange5 avait analysé dans sa thèse des phénomènes très intéressants où des enseignants s’approprient les listes de diffusion, qui servaient pour exprimer des revendications, échanger, se rassurer, militer ensemble. Il y a aussi eu une créativité extraordinaire dans la création de sites Web d’école au niveau du primaire, comme l’a étudié Jacques Audran dans sa thèse6. Plus récemment, on a vu le rôle grandissant des réseaux sociaux ou de sites non officiels où des communautés d’enseignants créent, partagent et parfois vendent des ressources pour leurs collègues.
Plus récemment Solène Zablot, qui a travaillé dans sa thèse de doctorat sur le baccalauréat professionnel de maintenance des véhicules automobiles, a constaté un recours très fort à ce qui est en ligne et à ce que des collègues préparent pour leurs collègues. C’est à mon avis vraiment intéressant. Il y a des sortes de proto-communautés d’enseignants qui mettent en ligne des choses pour leurs collègues, qui ensuite les modifient et les utilisent.
Par ailleurs, les militants pédagogiques ont depuis longtemps été très actifs dans la création et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, en particulier, le mouvement Freinet. Ce dernier, lui-même, est d’ailleurs un des théoriciens et des praticiens de l’enseignement programmé. On peut aussi citer, pour les ressources, entre autres, le GFEN, Groupe français d’éducation nouvelle.
M. Huchette. Finalement, c’est un autre aspect que les trois premiers que tu avais évoqués. Je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça, mais c’est l’influence de l’Internet. Là, tu parles plus de l’Internet et de la mise à disposition de ressources, somme toute, et des réseaux sociaux numériques sur la formation informelle ?
G.-L. Baron. Auparavant, en particulier dans les écoles normales, il y avait des formations organisées sur les usages pédagogiques des nouvelles technologies, sur l’audiovisuel, la télévision, puis l’ordinateur. Et quand il y a eu les IUFM, tout ce qui est les technologies de l’information et de la communication a eu une part modeste dans la formation générale commune (en revanche, dans les disciplines, c’est différent ; en particulier, les disciplines techniques ont pris ça en main très vite).
M. Huchette. L’existence de tels réseaux, de communautés numériques d’enseignants, c’est quelque chose qui passe un peu sous les radars de l’institution en termes de formation…
G.-L. Baron. Oui, des enseignants reçoivent par exemple une formation locale et puis après, il se passe des choses dans l’établissement, comme je l’ai dit, des sortes de proto-communautés d’enseignants mettent en ligne des ressources pour leurs collègues. Une partie des innovateurs est repérée par l’institution pour participer à des communautés de production de ressources supervisées par l’autorité pédagogique, qui se porte garante de la validité de ce qui est produit. Parmi les personnes qui y participent, certaines travaillent ensuite pour des entreprises privées. D’autres rejoignent des collectifs militants. Il y a des changements dans la société qui ont des effets dans l’éducation et qui ne sont pas directement pilotés par le ministère ayant donné les impulsions.
Une question que vous ne m’avez pas encore posée, c’est celle des nouvelles manières d’enseigner. Là aussi, il est clair que des choses ont changé, qui n’étaient pas directement prévues, et qu’elles vont continuer à changer. Une vraie question, à mon avis, c’est de savoir comment va évoluer cette fameuse forme scolaire qui a été théorisée par Guy Vincent et d’autres.
On peut d’ailleurs penser que derrière tout cela il y a l’idée d’une société sans école ou du moins avec moins d’école. C’est le discours d’Ivan Illich en 1970, où il y a échange de savoirs. C’est une vue relativement libertaire… Et puis en même temps, le système éducatif est bien régulé. Il ne va pas changer rapidement. Mais au fil du temps et par étapes d’une dizaine d’années, on peut voir des changements, qui ne sont d’ailleurs pas uniquement technologiques, mais politiques, avec le passage, en particulier à l’idée de fournisseurs d’éducation, « Education Provider », comme aux États-Unis, dans un monde beaucoup plus libéral.
Peut-être, le changement le plus notable, c’est le développement de formes d’éducation à distance, d’éducations hybrides. C’est quelque chose qui s’est développé finalement très vite, mais qui a aussi été soutenu par une volonté politique. L’idée de campus numériques a été largement subventionnée par le ministère dans la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix. L’université est un des secteurs où cela a beaucoup évolué. Maintenant, il y a une technostructure qui est assez élaborée, avec de nouveaux profils qui sont ceux des ingénieurs pédagogiques. Ils aident les enseignants, et parfois contraignent leur action. Il est difficile de prévoir ce qui va se passer avec les développements de l’intelligence artificielle. C’est la toute dernière vague, qu’il faudra suivre.
Y. Delabos. Est-ce que le développement de l’informatique en tant que technique, qui est beaucoup plus présente dans nos vies, est-ce que ça change notre rapport à la culture technique ? J’émets l’hypothèse qu’avant, la culture technique, c’était quelque chose qui était plutôt vu comme dégradant ou juste comme un outil, justement. L’omniprésence des technologies ne change-t-elle pas la situation en termes d’orientation ou d’entrée sur le marché du travail pour des jeunes et en termes de formation. Est-ce que ça ne donne pas une plus grande place à la technique par la présence d’une certaine culture technique ?
G.-L. Baron. Oui, mais, encore une fois, je ne pense pas que ce soit uniquement techno-déterminé. Je me souviens, qu’au début des années quatre-vingt, autour de responsables comme Claude Pair, il y avait cette idée au ministère que le technique et le professionnel allaient devenir l’excellence du xxie siècle. Et cela s’est marqué dans des décisions fortes, comme la création du baccalauréat professionnel. Encore une fois, les choses changent pour des raisons politiques, souvent parce que des solutions sont devenues assez consensuelles. Quant à l’informatique, il y a une constante dans les représentations sociales, c’est qu’elle représente l’avenir, même si l’avenir, on ne sait pas trop ce que c’est.
Souvent, des innovations techniques viennent d’entreprises, de startups. Il est trop tôt pour dire quelle est l’influence de tout cela. Ce qui est sûr, c’est que quand les humains utilisent la technique dans leur profession, ils ont besoin de formations à cet effet. Les techniques informatiques nécessitent la compréhension de concepts. Il faudrait sans doute regarder de plus près du côté de la didactique professionnelle.
M. Huchette. J’aimerais bien aborder avec toi la manière de faire de la recherche, la manière dont la recherche a appréhendé ces phénomènes. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ?
G.-L. Baron. Il y a eu beaucoup de recherches et d’innovations dans le domaine depuis les années 1960. Par exemple sur les circuits fermés de télévision dans les années soixante, dans les collèges expérimentaux, comme celui de Marly-le-Roi dans les Yvelines. Cela a beaucoup été ce que J. Wallet appelait des « approches d’essais ». On a essayé d’inventer des trucs et de voir comment cela marchait.
Le champ de recherche sur les technologies en éducation date des années soixante. Ce domaine n’a pas produit, du moins en France, de théorisation propre reconnue largement. Il a dépendu de la recherche qui se menait jusqu’alors et a été inspiré par différents secteurs : la psychologie cognitive et l’ergonomie (en particulier suite aux travaux de chercheurs comme Vergnaud, Rogalski, Samurçay, Rabardel), par l’informatique aussi (en particulier l’intelligence artificielle). D’autres disciplines contributives sont arrivées assez vite, comme la sociologie.
Dès 1970, dans La Reproduction, Bourdieu et Passeron analysent l’intérêt potentiel de l’enseignement programmé. Ils considèrent que rendre explicite, c’est une bonne chose7. On peut aussi citer des travaux pionniers comme ceux de Gabriel Langouët qui a travaillé à la fin des années soixante-dix sur les méthodes « audio-orales » pour l’enseignement de l’anglais au collège, des technologies éducatives de l’époque. Il a mené des études statistiques qui montrent, pour aller vite, que ces méthodes permettent aux élèves de progresser en anglais, mais que ceux de milieu favorisé progressent plus que ceux de milieu défavorisé. Il est un de ceux qui a introduit l’idée d’un différentiel lié au milieu social. Et avec la socialisation de l’informatique, de nombreux travaux intéressants sont apparus, qui s’appuient sur des travaux théoriques, comme ceux de Bourdieu, Derouet, Boltanski, et Lahire. Les didacticiens s’y sont aussi intéressés.
Des recherches dans ce domaine ont donc existé très tôt. Elles ont en général eu partie liée avec l’innovation et la pratique, des recherches participatives. Très souvent, elles ont eu un caractère aussi pluridisciplinaire.
Pour celles qui ont cherché à apprécier un effet sur l’apprentissage, on a constaté que le passage à l’échelle se faisait mal par rapport aux expérimentations. Les technologies évoluent tellement vite qu’une recherche qui est faite sur l’usage d’un logiciel X dans un contexte Y avec des programmes Z ne va plus marcher avec une technologie X', dans un contexte Y', avec un programme Z' différents.
Un des problèmes qui se pose régulièrement, c’est le lien entre la recherche et la décision. En quoi la recherche sert-elle aux décideurs ? Vaste sujet. Quand un pouvoir politique veut prendre des décisions, il considère les résultats de recherche qui l’intéressent. Par exemple, depuis quelques années, les décideurs politiques ont attaché de l’importance à l’instruction directe, voire à « l’enseignement scripté ». On a vu cela, d’ailleurs, dès les années 1960 (aux temps du behaviourisme triomphant), allant jusqu’à la recherche de modalités d’enseignement programmé qui seraient teacher-proof. Mais comment remplacer des enseignants ? Cela n’a pas très bien fonctionné.
Pour essayer de synthétiser, je crois beaucoup à l’intérêt des recherches participatives. Et j’ai été très influencé par des approches comme celle de Jean-Louis Martinand. Un des enjeux, c’est de travailler avec des praticiens et d’arriver à des résultats, certes, mais surtout à de nouvelles manières de problématiser, dont pourront s’emparer des communautés de praticiens. Et de ce point de vue là, on peut considérer qu’il y a eu des choses qui ont bien marché. J’ai parlé tout à l’heure de l’expérimentation assistée par ordinateur, j’aurais pu donner d’autres exemples. Il y a des choses qui se scolarisent.
M. Huchette. Merci Georges-Louis pour cet entretien.